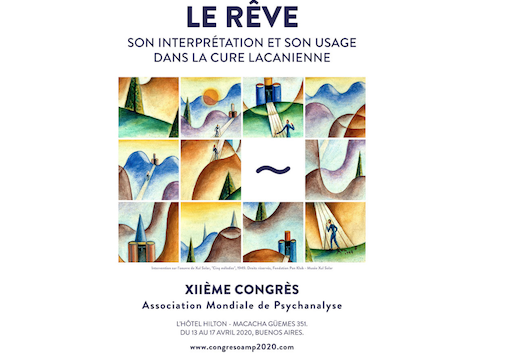« J’ai quand même le droit, tout comme Freud, de vous faire part de mes rêves. Contrairement à ceux de Freud, ils ne sont pas inspirés par le désir de dormir.
C’est plutôt le désir de réveil qui m’agite. Mais, enfin, c’est particulier. » [1]
Jacques Lacan
Introduction
C’est l’année 1900 qui marque le début de la psychanalyse. Freud publie « L’interprétation du rêve » [2]. Nous sommes dans notre orientation, l’orientation lacanienne, en train de centrer l’axe du XIIe Congrès de l’AMP qui aura lieu en 2020, soit cent-vingt ans plus tard, et dont le titre sera Le rêve. Son interprétation et son usage dans la cure lacanienne. Le rêve au singulier est le rêve qui se lie au rêveur, à un corps qui rêve, et qui parle de ce rêve à son analyste. Le rêve s’enchaine ainsi au corps parlant et à ce qui, de l’inconscient, se vérifie quand nous analysons le parlêtre.
Nous vivons dans une époque que certains décrivent comme étant celle de la transparence [3], il y a une perte de sens, tout s’expose et se montre de façon explicite, la distance entre l’intime et le public disparait. C’est l’époque de la « praxis de la post-privacy » [4]. Pourtant, les rêves continuent à maintenir un lien avec le plus intime de chacun et ils se présentent comme énigmatiques pour soi-même et pour les autres. Les rêves ne sont pas transparents ! Ils appellent l’interprétation. On ferme encore les yeux pour rêver !
Christine Angot a surpris les lecteurs avec son livre Une semaine de vacances [5]. Dans ce livre elle expose, de la manière la plus explicite, le rapport incestueux d’une jeune fille avec son père, sans aucun voile. Pourtant, ça ne va pas contre l’inconscient et Jacques-Alain Miller parle de la joie de l’inconscient [6], que l’on doit opposer à l’ennui propre de l’époque où la transparence nous laisse sans les couleurs du sens, la joie de l’inconscient face à l’enfer que vit la jeune fille devant la présence de ce père obsolète et pathogène [7]. « Pourquoi elle ne s’en va pas, en courant ? Pourquoi elle ne crie pas ? Pourquoi elle ne se débat pas ? Pourquoi elle ne s’enfuit pas ? ». Parce que le NON, la limite, le frein vient de l’inconscient. Le frein mis à ce père inarrêtable surgit de la voie royale de l’inconscient. Son rêve à elle, raconté [8], c’est la limite pour lui. Le lutin du désir introduit par un rêve produit la séparation qui met un barrage à l’enfer de ces vacances. Elle, passe d’être écrasée par son tropisme vers ce père à la « joie de l’inconscient ». Une joie qui ne signifie pas une fête de la jouissance, mais qui implique une entrée dans le monde des « extravagances du désir ». Il est peut-être possible que ce roman et le commentaire que J.-A. Miller en fait permettent de nous orienter dans une époque qui a changé par rapport à celle de Freud pour suivre la voie du désir singulier qui dit NON au pire. À ce qui, du Père, pourrait mener au pire [9].
Freud
Dans un petit texte de 1911, Freud fait usage du terme handhabung [10], qui a été traduit en espagnol par « utilisation » par Ballesteros et « usage » par Amorrortu, il a le sens d’utilisation, de maniement, etc.
Dans ce texte Freud avertit le médecin quel usage faire de l’interprétation des rêves. Il ne sera jamais licite de retarder l’intérêt de l’analyse au profit de l’exhaustivité de l’interprétation du rêve. C’est ce que Freud va expliciter lui-même dans l’un de ses écrits techniques : Conseils aux médecins sur le traitement analytique. Il y indique que l’analyste ne doit pas choisir car, s’il s’adonne à ses propres inclinations, sans doute fausserait-il la perception [11]. Il s’agit pour lui de soutenir la même attention, gleichschwebend [12]. Il n’y a pas d’exceptions à la règle qui consiste à, toujours, retenir la première chose qui vient à l’esprit du patient [13].
Un rêve est fait des mots, c’est un texte et c’est comme tel qu’il se lit. Freud est très précis sur ce point. Figure de rhétorique des mots, rébus, analogies, sont quelques-unes des expressions de Freud pour rendre compte qu’il ne s’agit pas de ce que le rêve veut dire, mais d’un texte.
Ce que Lacan dit dans le séminaire Encore ne laisse aucun doute : « Un rêve, ça n’introduit a aucune expérience insondable, à aucune mystique, ça se lit dans ce qui s’en dit, et qu’on pourra aller plus loin à en prendre les équivoques au sens plus anagrammatique du mot. » [14] Nous rappelons que Lacan trouvait, dans l’interprétation du lieu où F. De Saussure cachait ses anagrammes, la justification qu’il puisse, lui Lacan, passer de la linguistique a la linguisterie. Qu’il cesse, comme le dit J.-A. Miller, de délirer avec la linguistique [15]. Qu’est-ce que délirer avec la linguistique ? C’est faire de l’ordre symbolique la clé de la psychanalyse, d’un symbolique inadéquat au réel [16]. Faisons la distinction entre ce qui du rêve appartient au champ de la fiction œdipienne et le champ de lalangue. Lacan dit que le fait que l’analysant ne parle que de ses parents, se doit au fait qu’ils « lui ont appris lalangue. » [17]
Le rêve : son interprétation à la lumière du tout du dernier Lacan
Dans son Ouverture de la section clinique de 1977 [18] Lacan avance que « La clinique psychanalytique doit consister non seulement à interroger l’analyse, mais à interroger les analystes, afin qu’ils rendent compte de ce que leur pratique a de hasardeux, qui justifie Freud d’avoir existé » [19]. La clinique psychanalytique doit nous aider à relativiser l’expérience freudienne. « C’est une élucubration de Freud. J’y ai collaboré, ce n’est pas une raison pour que j’y tienne » [20]. Et, il ajoute, que l’on doit prendre en compte que la psychanalyse n’est pas une science exacte.
C’est dire que, quand il dit « j’y ai collaboré » et qu’il ajoute que ce n’est pas une raison pour qu’il en reste là, met la clinique, la pratique de chacun, au-dessus des théories, la sienne incluse.
En quel sens peut-on dire que la clinique et, particulièrement, la pratique — vu qu’il dit que les analystes rendent compte de ce que leur pratique a de hasardeux —sont au-dessus de la théorie ? Justement parce que la théorie reste dans le champ du nécessaire, c’est-à-dire dans ce qui ne cesse pas de s’écrire. Par exemple, l’affirmation « l’inconscient est structuré comme un langage », prononcée dans la première époque de Lacan, n’est en rien semblable dans son tout dernier enseignement. Lacan passe du langage structuré à lalangue, il produit un décollement.
Sur ce point que les analystes rendent compte « de ce que la clinique a de hasardeux », J.-A. Miller indique qu’à l’époque où il lisait Lacan et ne pratiquait pas encore la psychanalyse, il avait pensé qu’il y avait des règles de l’interprétation, mais que la pratique l’a fait s’écarter de cette idée [21]. Il s’agit de quelque chose qui ne rentre dans aucune case.
On peut donc dire que ce Congrès ouvre un temps et un espace pour interroger le rêve en ce que chaque pratique a de hasardeux et comment le rêve vient chaque fois rendre compte, ou non, d’un réel pour chacun.
Ainsi, pour J.-A. Miller, dans le tout dernier Lacan, « le clivage se fait entre l’œuvre de Freud, y compris son prolongement lacanien, et puis d’autre part un certain ras de terre de la pratique. »[22]
Chaque analyste, s’il est lacanien, devra être ouvert aux contingences et, pour cela, il a sa propre analyse où il pourra faire en sorte que « le dit se socie [23] », qu’il puise dit-socier, c’est-à-dire déstructurer l’inconscient structuré comme un langage.
Trois moments du rêve chez Freud
La thèse freudienne sur le rêve implique qu’il soit une réalisation [hallucinatoire] de désir. Freud a soutenu cette thèse pendant très longtemps et on pourrait dire, que tout le texte sur L´interprétation des rêves est construit pour soutenir et démontrer cette thèse. Il suffit de se souvenir de ces patients qui rêvaient pour démontrer le contraire et de la position de Freud qui ne reculait pas jusqu’à trouver le désir, moteur du rêve.
Chez Freud, on peut isoler trois temps. Le premier, où le rêve est une réalisation de désir et, par conséquent, le rêve se prête à l’interprétation. Le second, avec l’apparition de l’Au-delà du principe du plaisir où Freud doit reconnaitre qu’il y a des rêves qui ne sont pas une réalisation de désir et qui ne sont pas interprétables. Le troisième, enfin, où Freud rend les armes et accepte de changer sa thèse centrale sur les rêves. Il ne s’agira plus d’une exception, sinon que le rêve a un défaut.
Concernant l’interprétation, si on suit Lacan, il n’y a pas un seul rêve qui ne soit interprété par Freud selon la modalité du déchiffrement qui implique que le rêve soit énoncé. Le rêve d’Ana Freud[24] réalise le fait que « ses aliments étaient ceux dont elle devait se priver, ils lui étaient interdits ; qu’elle le rêve en articulant ces mots, démontre la présence directe, et je dirais même vivante, du langage. » [25]
La limite à l’interprétation des rêves est présente depuis le commencement quand Freud fait le postulat de l’ombilic du rêve. Néanmoins, dans le troisième temps dont nous parlons, il fait un pas de plus.
Avec J.-A. Miller on peut dire que la différence entre l’interprétation freudienne et lacanienne se situe dans le fait que la première est une traduction que Freud invente à propos des rêves quand il s’arrête au sens sexuel, tandis que l’interprétation lacanienne se dirige au non rapport et à l’impossible à dire et fait une place à l’aléatoire [26].
Le rêve comme un produit pathologique constitue une étrangeté temporaire du monde extérieur, une sorte d’« inoffensive psychose » [27]. Mais, en même temps, il le met du côté d’une opération utile, en rapport au besoin de repos qui assure la continuité du sommeil. De nouveau, nous trouvons ici l’utilisation du rêve. Freud parle de « chemin inoffensif de la satisfaction hallucinatoire » [28].
La vision, ou figurabilité à la manière d’une transposition des représentants en image, est le mécanisme de cette hallucination inoffensive et le compromis est ce qui permet une issue à la motion pulsionnelle. À partir de ce point il redéfinit sa thèse centrale et souligne qu’il ne s’agit pas d’une exception, mais d´un changement structurel. Dans son texte Au-delà du principe du plaisir, l’exception se référait aux rêves traumatiques, mais il arrive à déduire que la « fixation inconsciente à un traumatisme semble être au premier rang de ces obstacles à la fonction du rêve. » [29] C’est dire que, alors que tout sujet a une fixation au trauma, le rêve serait une « tentative de réalisation », mais avec la possibilité d’être en défaut étant donné que la levée du refoulement nocturne permet à « la poussée de la fixation traumatique de devenir active. » [30] La fonction du rêve, comme tout acte psychique de plein droit, est de « transformer les traces mnésiques de l’événement traumatique en un accomplissement de désir. » [31] Dans ce cas, le processus est mis en échec.
Nous pouvons ordonner les choses de la manière suivante : il y a des visions dans les rêves qui laissent le sujet du côté du sommeil, qu’avec Freud nous pouvons appeler un « vécu hallucinatoire inoffensif » [32], mais il y en a d´autres qui réveillent le sujet et qui le confrontent avec ce qui n’a pas pu être élaboré, la pulsion affleurant de la fixation traumatique.
Un rêve de Freud
J.-A. Miller nous rappelle que, pour Lacan, le statut de l’inconscient n’est pas ontique mais éthique ; il dit qu’il est tout à fait légitime que quelqu’un n’espère rien d’un rêve, ni de son sens. Mais, « il faut qu’il y ait, à l’origine, un sujet qui décide au contraire de ne pas être indifférent au phénomène freudien. » [33]
Ne pas être indifférent au phénomène freudien — qui n’est pas la même chose que d’interpréter les rêves à la manière freudienne — veut dire qu’il faut décider être analysant et, de plus, analysant de son propre « je n’en veux rien savoir ». La position analysante est au-delà de cette légitimité et elle implique un forçage qui se démontre dans le Rêve de l’injection faite à Irma.
Dans tout rêve, dit Freud, il y a un associé capitaliste et un associé industriel : le moteur du rêve et la cause du rêve. Le moteur est le désir inconscient et la cause est le reste diurne, c’est-à-dire ce qui est resté en suspens. Dans le Rêve de l’injection faite à Irma, ce reste est le commentaire fait par Otto ; reste imprécis, très bien noté par Freud, de l´intonation de la voix qui resta comme une résonnance. Freud a l’idée que l’on rêve pour continuer à travailler ; c’est ce qu’il appelle le travail du rêve. Il y a un rapport tout à fait étroit entre la fonction du reste et la fonction de la cause.
Lacan souligne deux interruptions différentes dans Le rêve de l’injection faite à Irma. Premièrement, il s’agit d’un Freud qui essaie, littéralement, de faire ouvrir la bouche à Irma. Il veut examiner sa gorge et, ceci, en même temps qu’elle parle. Irma résiste et quand Freud arrive à lui faire ouvrir la bouche, il se trouve confronté à une image complètement angoissante pour lui. Ce qu’il voit dans cette gorge est quelque chose qui l’angoisse. Il y a là quelque chose d’un autre registre : « […] un spectacle affreux […] très peu de temps avant ou après, Freud se fait opérer par Fliess, ou par un autre, des cornets du nez. […] une horrible découverte, celle de la chair que l’on ne voit jamais, le fond des choses, l’envers de la face. »[34] La chair de laquelle tout surgit, le plus profond du mystère, « la chair souffrante que sa forme, par soi-même, est quelque chose qui provoque l’angoisse. […] identification d’angoisse, dernière révélation. […] » [35].
Lacan s’interroge de savoir pourquoi Freud ne se réveille pas ? Sa réponse, c’est qu’il a du cran ! Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Freud est décidé à aller au-delà de son je n’en veux rien savoir. Il est décidé à arriver jusqu’au plus profond de l’inscription de la marque sur le corps. Ce n’est pas par hasard que Lacan se réfère à la chirurgie nasale, il y a quelque chose du corps qui se met en jeu dans ce rêve, du corps comme corps parlant et jouissant, au-delà du narcissisme, au-delà de l’image, ou plutôt, comme le dit Lacan dans le Séminaire XXIII, « […] cette image confuse n’est pas sans comporter des affects […], il y a quelque chose de psychique qui s’affecte, qui réagit, qui n’est pas détaché, à la différence de ce dont Joyce témoigne […] » [36].
Toutes les références que donne Lacan font ressortir que ce à quoi Freud s’affronte dans ce rêve est quelque chose qui ne peut pas se nommer, ne peut pas se voir, n’a pas de sens, qui est totalement mystérieuse, indéchiffrable, innommable. Dans le retour de l’imaginaire et du symbolique tout peut se nommer, que ce soit la prévalence de l’imaginaire, ou celle du symbolique. Il y a un moment dans le rêve ou apparait quelque chose d’un autre registre qui produit un affect, l’angoisse. Ceci ne peut pas être pris ni pour symboliser l’image, ni pour imaginariser le symbole. Il y a quelque chose qui freine ce devenir, qui l’arrête et c’est pour cela que Lacan se demande, pourquoi il ne se réveille pas. C’est sur ce point du rêve que Lacan situe le réel : « Il y a donc apparition angoissante d’une image qui résume ce que nous pouvons appeler la révélation du réel dans ce qu’il a de moins pénétrable, du réel sans aucune médiation possible, du réel dernier, de l’objet essentiel qui n’est plus un objet, mais ce quelque chose devant quoi tous les mots s’arrêtent […] : l’objet d’angoisse par excellence. » [37] Nous avons dans la même place le réel, l’angoisse, l’organe sexuel féminin et la mort. Pourtant, il faut dire que cette vision angoissante ne laisse d’avoir un cadre imaginaire aux limites de l’ouverture de la bouche.
Il y a une deuxième interruption liée selon Lacan à l’écriture. Ce n’est pas la vision de quelque chose d’atroce mais la limite même des mots : « Et ce mot ne veut rien dire sauf qu’il est un mot » [38]. « Le rêve […] culmine […] dans une formule écrite, […] au-delà de ce que nous ne pouvons pas ne pas identifier comme la parole, la rumeur universelle. Tel un oracle, la formule ne donne aucune réponse à quoi que ce soit ». [39]
On peut trouver ainsi deux limites au circuit du symbolique et de l’imaginaire. Quand on rêve (Is) on trouve des interruptions liées au réveil et on devrait vérifier chaque fois quel type d’interruptions nous avons. Mais, lorsqu’on interprète un rêve (Si) il y a aussi une limite qui s’appelle l’ombilic du rêve. Dans les deux cas la structure du rêve avec son réveil et sa limite nous permettent de repérer une orientation dans la cure.
Pour conclure : le rêve dans la cure lacanienne
Le mot usage introduit à un au-delà des fictions de l’être et J.-A. Miller met ce concept à la hauteur de celui de structure. Il déstructure le système symbolique pour nous introduire au syntagme usage logique du sinthome. Il s’agit, selon J.-A. Miller, d’une pragmatique supérieure.
Le rêve se lit hors de toute signification et s’ordonne à partir de la lettre, celle de l’hérésie joycienne. Joyce coupe le souffle du rêve de la littérature et le réduit à sa vérité de fiction. Par contre, lui, fait litura, litter avec la lettre, laisse le lecteur, qui essaye de comprendre, perplexe. Le rêve comme la V de Vespe de l’Homme aux loups peut faire surgir une lettre qui creuse le lieu de la jouissance dans son opacité.
Dans son cours du 2 mars 2011, J.-A. Miller dit qu’il y a des rêves où, à l’occasion, on rencontre une « jouissance non symbolisable, indicible, qui a des affinités avec l’infini […] qui n’a pas été concassée par la machine non-oui » [40].
Dans certaines psychoses le rêve n’appelle pas à l’interprétation et peut être une manière d’apaiser l’insupportable de l’hallucination. Dans un cas clinique, un jeune homme mélancolique raconte un rêve pendant son hospitalisation. Tout d’abord, il dit qu’il ne rêvait pas avant d’être à l’hôpital. Et, là, il dit : « Hier j’ai rêvé que je faisais mon traitement avec vous et que vous me proposiez une cure alternative ; cela me donnait de l’espoir. » Depuis son enfance ce jeune homme se sent indigne face à l’Autre et c’est encore ainsi aujourd’hui. Il peut, à partir de ce rêve, penser la possibilité d’une « alternative » ; c’est-à-dire quelque chose de l’ordre d’une altérité qui lui permettrait une vie supportable avec l’autre. Cela donne une indication à l’analyste sur sa place, toujours liée à sa position de petit a, un alter ego qui lui rend possible le fait de parler.
Le rêve comme formation de l’inconscient se règle par la logique interdiction/permission, tel le rêve d’Ana Freud. La jouissance doit être refusée pour être atteinte dans l’échelle inversée de la loi du désir.
Mais, lorsque Lacan conceptualise la sexualité féminine comme le régime de la jouissance en tant que tel, il ne s’agit plus d’interdiction/permission, la jouissance ne demande pas de permission pour s’éprouver, elle est événement de corps et opaque pour être rebelle au sens. Mais elle n’est pas rebelle à la logique, vu qu’il s’agit d’un réel qui peut se démontrer. Il s’agit d’une logique dans le sens aussi d’une monstration, d’un réel qui pousse à se démontrer en acte : « Ce que je ne puis exprimer – dit le dernier Montaigne – je le montre du doigt. » [41]
Donc, le rêve s’enchaine avec cette logique et son usage se lie au corps parlant.
Dans le Séminaire XXIV, Lacan ouvre son travail de cette année en affirmant qu’il va introduire quelque chose qui va plus loin que l’inconscient. Il se demande aussi pourquoi on se force dans l’analyse des rêves à s’en tenir à ce qui s’est passé la veille. Sans doute parce que « Freud en a fait une règle. » [42]
Dans son tout dernier enseignement le mot se transforme complètement et on peut dire qu’il devient détritus, reste, pure satisfaction langagière. L’une-bévue fait apparaitre un inconscient d’un autre registre et c’est un instrument apte pour que le parlêtre fasse usage de la psychanalyse. L’une-bévue, l’unbewussten, pure homophonie, joie de l’inconscient.
Nous citons J.-A. Miller sur ce point que l’une-bévue « appelle à un signifiant qui serait nouveau, pas simplement parce que ce serait un en plus, mais parce qu’au lieu d’être contaminé par le sommeil, il déclencherait un réveil ». [43]
À partir de son usage et pas seulement de son interprétation le rêve garde son actualité dans notre époque. Le prochain Congrès aidera à nous orienter, nous analystes, dans la lecture du rêve dans la cure lacanienne.
[1] Lacan J., « La troisième », La Cause freudienne, n° 79, Paris, Navarin/ Seuil, 2011, p. 24.
[2] Freud S., L’interprétation du rêve, Paris, Seuil, 2010, p. 704.
[3] Byun-Chul Han, La sociedad de la transparencia, Barcelona, Herdereditorial, 2013, p. 36.
[4] Ibid.
[5] Angot C., Une semaine de vacances, Paris, Flammarion, coll. J´ai lu, 2012.
[6] Miller J.-A., Encuentro con J.A. Miller, Jam Session, Feminismos, variaciones y controversias, COL, Buenos Aires, Grama Ediciones, 2018, p. 22.
[7] Ibid., p. 19.
[8] Angot C., op. cit., p. 92.
[9] Naparstek F., « De lo insoportable del padre a la alegría del inconsciente », (Comentario sobre el encuentro de J.-A. Miller con Christine Angot en el Teatro Sorano), p.48-49.
[10] Freud S., « Le maniement de l’interprétation des rêves en psychanalyse », La technique psychanalytique, Paris, PUF, 1977, p. 43.
[11] Freud S., « Conseils aux médecins sur le traitement analytique », La technique psychanalytique, Paris, PUF, 1977, p. 65.
[12] Miller J.-A., Conferencia « Punto de capitón », 24 de junio 2017, http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=publicaciones&SubSec=on_line&File=on_line/jam/Otros-textos/17-06-24_Curso-de-psicoanalisis.html
[13] Freud S., « Conseils aux médecins sur le traitement analytique », op. cit., p. 66.
[14] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, texte établi par J.-A. Miller, 1975, p. 88.
[15] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, leçon du 02/05/2007, inédit.
[16] Ibid.
[17] Lacan J., « Vers un signifiant nouveau », Ornicar ?, N° 17/18, Printemps 1979, p. 13.
[18] Lacan J., « Ouverture de la section clinique », Ornicar ?, N° 9, 1977, Paris, p. 7-14.
[19] Ibid., p. 14.
[20] Ibid.
[21] Miller J.-A., « Le mot qui blesse », La Cause freudienne, N° 72, Navarin/Seuil, 2009, p.133.
[22] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan », op. cit., leçon du 16/05/2007, inédit.
[23] Lacan J., « Ouverture de la section clinique », op. cit., p. 7.
[24] Freud S., L’interprétation du rêve, op. cit., p. 169.
[25] Lacan J., Le phénomène lacanien, Conférence prononcée au Centre Universitaire Méditerranéen de la Promenade des Anglais, en 1974. Texte établi par J.-A. Miller, Tiré à part de la Section clinique de Nice, 2011.
[26] Miller J.-A., « Le mot qui blesse », op.cit., p. 135.
[27] Freud S., « Révision de la théorie du rêve, », Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, XXIXe, Paris, Gallimard, NRF, 1984, p. 25.
[28] Ibid., p. 26.
[29] Ibid., p. 44.
[30] Ibid.
[31] Ibid.
[32] Ibid., p. 26.
[33] Miller J.-A., « Habeas Corpus », La Cause du désir, N° 94, Paris, Navarin, novembre 2016, p. 166.
[34] Lacan J., Le Séminaire, livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Paris, Seuil, 1978, p. 186.
[35] Ibid.
[36] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome. Paris, Seuil, 2015, p. 149.
[37] Lacan J., Le Séminaire, livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. op. cit., p. 196.
[38] Ibid., p. 202.
[39] Ibid., p. 190.
[40] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’un tout seul », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, leçon du 2/3/2011, inédit.
[41] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan », op.cit., leçon du 30/05/2007, inédit.
[42] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIV, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », leçon du 16 novembre 1976. Inédit.
[43] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan », op.cit., leçon du 14/03/2007, inédit.