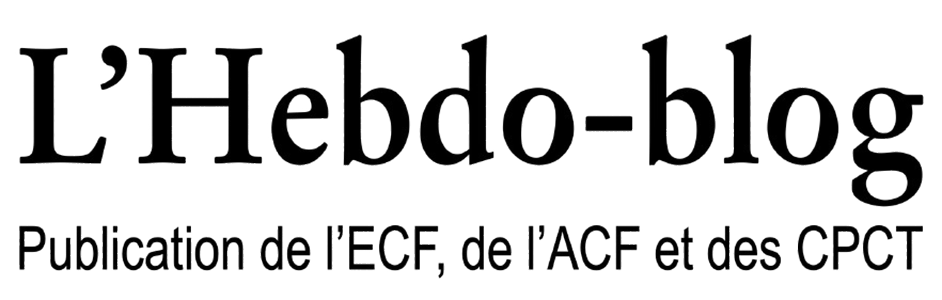« L’inconscient, c’est la politique ! »[1] affirme Lacan en mai 1967. Une phrase tout à fait étonnante et marquante. Étonnante, car on a normalement l’habitude de penser à l’inconscient comme à quelque chose de singulier, de personnel. Marquante, car malgré tout, une fois entendue, cette phrase résonne en nous et nous transmet quelque chose que nous ressentons comme vrai, familier, quelque chose, en somme, qui a toujours été en nous, même si nous ne l’avions jamais formalisé de cette façon.
En effet, cette affirmation de Lacan ne fait que résumer de façon brillante ce qui avait été déjà dégagé par Freud, à savoir que la politique s’appuie sur le mécanisme de l’identification. « On gouverne l’homme par l’identification »[2], écrit J-A Miller dans son article Quand les semblants vacillent. Le XXe siècle a montré toute la puissance de cette logique, qui a pu arriver jusqu’à la négation des certains principes fondamentaux de la société humaine, principes que, dans le rêve de la raison, on avait pu estimer inébranlables.
L’expérience analytique permet de toucher du doigt toute la puissance des processus identificatoires. Au fur et à mesure que le parcours analytique avance, on se rend compte que tout ce qu’on avait pu penser avoir choisi librement, ce n’était que la conséquence d’un signifiant maître qui nous gouvernait. Si l’analyse nous permet de reconnaître que nous jouissions d’une identification, elle ne nous permet pas pour autant de nous en passer une fois pour toutes, de nous affranchir définitivement de ça. Bien entendu, ce n’est pas la même chose. Toutefois, comme éclaire J.-A. Miller dans le même article, ce qui peut se produire dans l’analyse est un vacillement des semblants et non pas un effacement. Les semblants, eux, restent, restent pour toujours. C’est tout ce que nous avons : nous ne pourrons jamais sortir de là. La question devient : comment avoir affaire à ces semblants ?
Cette sensation est tout à fait saisissante si on se réfère à l’expérience politique. Dans la vie de tous les jours, nous sommes appelés à nous confronter avec ce registre pour exercer notre droit – et notre devoir – de voter aux élections. Toutefois, une des réactions qu’il peut se produire, notamment pendant un parcours analytique, c’est que cette politique puisse nous dégouter. S’il y a eu au moins un tout petit vacillement de ces semblants, il apparaît très clairement que toute parole proférée dans le discours politique est parole vide, aride, postiche. Ce sentiment, d’ailleurs, est bien répandu et il ne se limite pas seulement à ceux qui se sont engagés dans une analyse.
Ainsi, si d’un côté on a l’irrésistible montée des partis extrémistes, chose que la seule raison n’arrive pas à expliquer, de l’autre côté on assiste à une séparation toujours plus nette entre les citoyens et la politique. Voilà deux faces d’une seule et même menace à laquelle nous devons nous confronter aujourd’hui : la possible disparition de la démocratie.
Ce qui reste, je peux en témoigner en première personne, c’est un grand sentiment d’impuissance. Quoi faire, pour se défendre d’une menace réelle – le siècle dernier l’a démontré – avec nos moyens d’aujourd’hui ? J’ai l’impression de me trouver dans une impasse. On a vu que la politique menée sous les insignes des idéaux a produit les choses les plus horribles que l’homme ait pu faire. Pas question donc de s’identifier à un S1 proposé par un parti, d’autant plus que les partis d’aujourd’hui semblent s’appuyer de moins en moins sur des idéaux. Le dégout règne souverain pas seulement pour les partis extrémistes, mais aussi pour ceux qui ont été au pouvoir jusqu’à-là et nous exposent, maintenant, à la brutalité de ces mouvements qui proposent de tout régler par la force. Pas question, non plus, de ne pas voter : cela aiderait l’ennemi.
Ennemi, d’ailleurs, qui est déjà bien présent et bien en force. Je le dis ici en passant, mais en même temps que la journée Question d’École du samedi 4 février, à Macerata, en Italie, un jeune de 28 ans, avec une expérience politique dans le parti de la Lega Nord[3], décide de monter dans sa voiture et, armé d’un pistolet, de tirer sur tous les immigrés qu’il pouvait rencontrer sur sa route. Il a fait six blessés. Acte de terrorisme qui, malheureusement, n’est pas nouveau. Ce qui a été nouveau, pourtant, c’est qu’un autre parti politique d’extrême droite – Forza Nuova – a pris ouvertement les défenses de ce jeune, en soutenant qu’il serait la victime, amenée à l’exaspération par cette politique incompétente, et en disant qu’il mettra à sa disposition ses avocats pour le défendre face aux juges. Le fascisme est désormais prêt, donc, à faire son retour sur la scène sociale sans devoir plus penser à se cacher ou à se camoufler.
Que faire, donc ? Que faire de ce dégout qui nous éloigne de la politique et ouvre la voie aux extrémismes ? Comment participer à la politique, si on refuse de s’identifier à un parti ? Existe-t-il une façon d’être politiques sans nécessairement passer par l’identification ? C’est ici que je regarde à l’expérience analytique avec de l’espoir.
L’analyse ne fait pas de nous des sujets non-identifiés, mais des sujets désidentifiés, poursuit J.-A. Miller[4], en faisant écho à ce qui avait été dit par Lacan. C’est-à-dire que si on ne peut pas se passer de l’identification, il y a quand-même la possibilité de la traverser. Que peut-il surgir de cette traversée de l’identification ?
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XIV, « La logique du fantasme », Leçon du 10 mars 1967, inédit.
[2] Miller J.-A., Quand les semblants vacillent, La Cause freudienne, 03/2001, Paris, Navarin / Seuil, n°47, p. 7 (édition numérique).
[3] Parti italien d’extrême droite, allié, au parlement européen, du Front National de Marie Le Pen.
[4] Miller J.-A., Quand les semblants vacillent, op. cit., p.8.