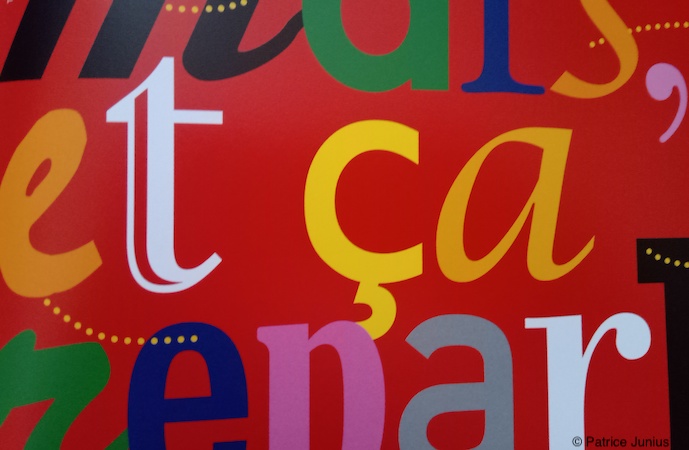« Ce peuple dont la vocation fut de coloniser des espaces immenses … »
Léon Tolstoï, Anna Karénine
2022 a vu la Russie renouer avec sa funeste tradition de menace et de conquête de ses voisins. Et ceci dans deux directions, aussi bien l’est que l’ouest. La mémoire des plus âgés se rappelle la guerre froide, l’écrasement sanglant de la révolution hongroise de 1956, le mur de Berlin en 1961, le Printemps de Prague en 1968, tandis que l’histoire contemporaine remonte plus loin pour retenir Pierre le Grand, Catherine II, Staline, et l’histoire plus ancienne le bien nommé Ivan le Terrible ! Si l’Europe s’est réveillée en sursaut, elle aspire à pouvoir se rendormir au plus vite. Des voix de la droite classique, d’autres de droite plus ou moins extrême, d’autres encore de gauche égarée, trépignent même d’impatience mues sans doute par une trouble fascination de l’autocrate en colère.
Cioran a consacré, peu après la révolution hongroise, un texte incandescent à l’impérialisme russe qu’il décrit fondé sur l’autocratie, soit sur un maître, un tyran qui ne connaît ni dialectique ni compromis, sans vacillation – texte signalé par Kundera dans son texte retentissant Un occident kidnappé [1]. L’autocrate n’est donc pas un père, fût-il Petit père des peuples, comme on nommait improprement les tsars et Staline ensuite, mais un Un absolu [2]. Cioran ne fait d’ailleurs aucune différence sur ce plan entre les tsars classiques et les tsars rouges, entre Pierre le Grand et Staline – il considère même que la Russie aura slavisé le marxisme [3]. Le pouvoir absolu serait pour la Russie le fondement même de son être, et la liberté un virus dangereux [4].
Cet impérialisme dont l’auteur situe les fondements dans un mélange de religion orthodoxe (Moscou serait la troisième Rome, héritière du vrai Christianisme après la chute de Constantinople en 1453) et de slavophilisme (le génie de la Russie sauveur de l’humanité, la Russie ayant arrêté et résorbé l’invasion mongole au XVe siècle) apparaît néanmoins, telle la rose d’Angelus Silesius, sans pourquoi. Il ne s’agit pas selon lui de conquête au sens classique du terme, ni du colonialisme capitaliste ordinaire, mais de s’étendre pour s’étendre : « Elle n’a, en outre, nulle honte de son empire ; bien au contraire, elle ne songe qu’à l’étendre » [5]. Et la question de la folie, parfois indubitable, de tel ou tel de ces autocrates est secondaire sinon futile puisqu’ils trouvent tous un discours dans lequel se loger. Autrement dit pulsion et volonté de jouissance semblent être passées à l’état de tradition historique toujours vivace. L’auteur ne voit d’ailleurs ce qu’il appelle des zones de vitalité – fussent-elles marquées par ce qu’il appelle le goût de la dévastation et de la pagaille intérieure, voire par un reste de sauvagerie –, qu’à l’est de l’Europe, l’ouest ressemblant de plus en plus selon lui à la Suisse, pays de l’hygiène et de la fadeur.
Cioran considère que la question de savoir quelle est la mission de la Russie, du colosse russe, en ce bas monde est tranchée : « Le colosse a bel et bien un sens, et quel sens ! Une carte idéologique révélerait qu’il s’étend au-delà de ses limites, qu’il établit ses frontières où il veut …, et que sa présence évoque partout, moins l’idée d’une crise, que d’une épidémie, salutaire parfois, souvent nuisible, toujours fulgurante. » [6]
(À suivre)
Philippe Hellebois
________________________
[1] Cioran E., « La Russie et le virus de la liberté », Histoire et utopie, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 2011, p. 446-458 ; Kundera M., Un occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale, Paris, Gallimard, Le débat, 2021, p. 52.
[2] Sur ce point voir Miller J.-A., « En direction de l’adolescence », Interpréter l’enfant. Travaux récents de l’Institut psychanalytique de l’Enfant, n°3, Paris, Navarin, 2015, p. 200-202.
[3] Cf. Cioran E., op. cit. p. 450.
[4] Cf. ibid., p. 454.
[5] Ibid., p. 452.
[6] Ibid., p. 457.