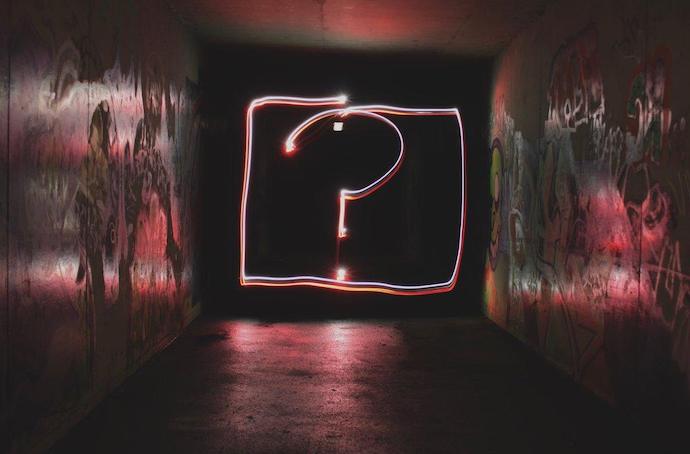Rappels concernant la demande
À suivre le Lacan de « La direction de la cure… », les paradoxes de la demande peuvent être saisis à partir d’un petit mathème proposé par Jacques-Alain Miller dans les années 80 : D / d[1] (grand D de la demande sur le petit d du désir ; écriture qui fait écho à l’algorithme saussurien revisité par Lacan : S/s). Dans ce même texte de 1958[2], et d’une manière plus précise dans « Subversion du sujet… »[3], ces paradoxes trouvent à être questionnés cette fois-ci à partir d’un ternaire : besoin/demande/désir. Enfin, n’oublions pas que Lacan distingue trois formes de demandes : celle relative à la satisfaction du besoin, celle accrochée à l’Autre comme demande d’amour, et enfin, celle relative à la pulsion où il fait se rejoindre chaîne signifiante et jouissance[4]. Ces trois déclinaisons trouvent à s’inscrire au sein du graphe du désir.
Du point de vue clinique, la référence de Lacan est bien sûr la névrose, avec une demande qui peut se décliner sous deux formes, suivant l’objet qui prévaut : « […] demander à l’Autre l’objet qu’il recèle [objet oral], ou se faire demander par l’Autre le règlement de la dette qui lui est due [objet anal]. »[5] La condition de la demande étant, dans les deux cas, la perte de l’objet et sa remise dans l’Autre – que le sujet fait alors exister.
Dans la psychose
Mais qu’en est-il dans la psychose, là où précisément l’objet n’est pas extrait ? Peut-on parler de demande et si oui, à quelles conditions, et sous quelles formes ? Surement allons-nous obtenir des réponses à notre journée FIPA du 17 mars où interviendront beaucoup d’institutions de psychanalyse appliquée recevant des sujets psychotiques, mais pour l’heure, avançons quelques remarques introductives, et quelques hypothèses.
Si les objets qui prévalent au sein de la demande sont les deux objets freudiens, et si la demande est problématique dans la psychose, nous en déduisons que dans cette dernière ce sont plutôt les deux autres objets, dits « lacaniens, » qui sont prévalents. Et du reste, c’est à partir de son intérêt pour la psychose que Lacan a pu formaliser l’objet regard et l’objet voix, respectivement comme ce qui ne peut se voir et ce qui ne peut s’entendre. En effet, vous ne trouverez nulle caméra au domicile du paranoïaque certain d’être surveillé, ni nul enregistrement des voix que l’halluciné assure pourtant entendre.
Dès lors, par quel biais pouvons-nous approcher ce registre de la demande dans la psychose, en l’adaptant surement ? Il serait tout d’abord tentant de nous référer à la troisième modalité de demande évoquée plus haut, celle dite pulsionnelle, relative aux signifiants corporels. Seulement cette dernière, comme l’écrit Lacan dans son graphe ($ <> D), convoque un sujet barré, lié par ailleurs à un objet au sein du fantasme ($ <> a) dont la condition est justement l’extraction de l’objet. Ainsi ne pouvons-nous pas nous y référer. Soutenons alors, en référence avec le Lacan du Séminaire XI[6], et à sa nouvelle approche de la pulsion, que dans la psychose, elle ne se bouclerait pas (là encore, faute d’extraction de l’objet). Plus précisément, faute de la séparation, la « pulsion émerge dans le réel »[7], avec pour conséquence les phénomènes de corps, avec une pulsion « non domestiquée », qui « ne s’articule pas gentiment à l’objet petit a. »[8] Nous évoquons donc ici deux modalités de retour dans le réel qui se rejoignent, l’une approchée sous l’angle de la pulsion et du corps, l’autre sous l’angle de l’objet a.
Deux modalités de rencontre
Fort de ces quelques apports théoriques, abordons deux modalités de rencontre avec le sujet psychotique, disons très contemporaines car assez éloignées, à première vue, de celle plus « classique » d’un sujet qui, suite à un déclenchement ou à un débranchement, vient témoigner de ses phénomènes énigmatiques et intrusifs, étant à la recherche de sens, d’un bouclage de la signification. Nous nous intéressons plutôt ici aux sujets qui, soit ne demandent strictement rien, soit s’adressent à nous dans l’urgence – signe d’un envahissement qui n’est que le reflet de celui qu’ils disent subir de la part de l’Autre – ne formulant aucune demande à proprement parler.
Dans le premier cas, ne devons-nous pas amener progressivement le sujet à isoler ses points de perplexité et d’énigmes, en lien avec ses phénomènes élémentaires, pour qu’il puisse enfin s’en plaindre, prémisse nécessaire à toute formulation de demande, par exemple d’en être protégés ou de les faire disparaître. Dans le second cas, disons que l’opération première consiste d’abord à contenir et apaiser cette jouissance en excès, toujours avec l’arme du symbolique et de la parole, mais aussi ici du silence, pour, dans un temps second, amener là encore le sujet vers ses points de perplexité que nous allons en quelque sorte « problématiser ». Moins revendicateur ou dénonciateur, le sujet peut alors devenir demandeur. Et dans les deux cas, ce repérage qu’autorise l’adresse à celui devenu « secrétaire actif », pour reprendre un terme d’Éric Laurent, s’accompagne bien évidemment d’un traitement de la jouissance, qui certes ne se négativera pas, mais pourra emprunter d’autres circuits…
Pour conclure disons qu’à chaque fois il s’est agi de faire naître une demande, signe qu’une relative remise à l’Autre de ce qui faisait précédemment excès a opéré, et qu’un certain savoir y faire avec cet insupportable s’est élaboré. Et parions qu’alors d’autres demandes pourront se formuler de la part du sujet, dans et vers d’autres lieux, conditions nécessaires pour toute inscription dans le lien social.
[1] Cf. par exemple : Miller J.-A., « Trio de Melo », La cause freudienne, n°31, oct. 95, p. 9-19.
[2] Lacan J., « La direction de la cure et les enjeux de son pouvoir », Écrits, Seuil, Paris, 1966, p. 679.
[3] Lacan J, « Subversion du sujet et dialectique du désir », Écrits, op. cit. p. 814.
[4] Cf. Miller J.-A., « La pulsion est parole », Quarto, Revue de la cause freudienne, ACF en Belgique, n°60, 1996, p. 14-15.
[5] Miller J.-A., « Clinique ironique », La cause freudienne, n°23, fév. 93 p. 12.
[6] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), Paris, Seuil, 1973, chap. 14 et 15.
[7] Cf., Miller J.-A., « Conversation sur les embrouilles du corps », Ornicar ? revue du Champ freudien, n°50, Paris, Navarin/Seuil, 2002, p 240.
[8] Ibid. p. 239.