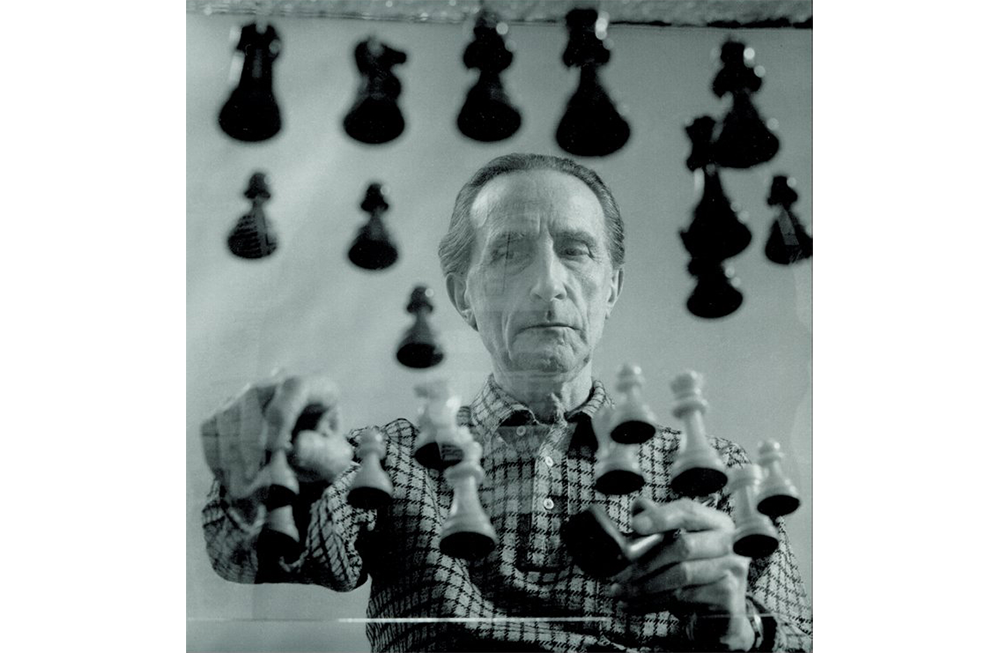L’Hebdo-Blog s’entretient avec Rose-Paule Vinciguerra à propos de son livre Femmes lacaniennes récemment paru aux éditions Michèle (Paris, octobre 2014).
Rappelons que l’Association des psychologues freudiens et l’Envers de Paris organisent une rencontre avec Rose-Paule Vinciguerra autour de ce livre, le vendredi 7 novembre à 20h30, au 31 rue de Navarin, Paris 9e. Sophie Gayard sera discutante.
L’Hebdo-Blog – Pourquoi ce titre Femmes lacaniennes donné à votre livre ?
Rose-Paule Vinciguerra – J’ai tenté de repérer en quoi le dire novateur de Lacan sur les femmes avait changé l’abord de la pratique et de la théorie psychanalytiques.
L’H-B – Vous rappelez que Jacques Lacan souligne que les femmes sont « plus réelles »[1] parce qu’elles n’existent qu’une par une, mais les hystériques femmes sont-elles aussi plus réelles ?
R.-P. V. – Les hystériques femmes, si elles font l’homme, n’en sont pas moins des femmes ! La question est de savoir en quoi ce réel des femmes que Lacan a repéré notamment avec le pas-tout, leur permet, lorsqu’elles sont analystes, de laisser les analysants s’avancer vers une zone énigmatique et contingente au-delà des effets du symbolique dans la cure. Mais cela ne veut pas dire que les analystes femmes soient spontanément mieux orientées que les hommes ni que les hommes soient exclus de ce pas-tout.
L’H-B – Au plus près du Séminaire « R.S.I. » de J. Lacan, vous développez très précisément qu’un homme qui se met à croire à une femme fait exister La Femme : quelles peuvent en être les incidences cliniques pour le sujet masculin?
R.-P. V. – Lacan distingue entre croire à une femme comme on croit à son symptôme et la croire et il ramène cette distinction à celle de la croyance névrotique et de l’index de certitude dans la psychose ; c’est dans le second cas qu’un homme crée La femme. Mais installer une femme en position de La femme, cela se rencontre aussi dans l’amour, dans l’homosexualité masculine… Les surréalistes, eux, « suppléaient »[2] à La femme qui n’existe pas, comme le dit Lacan.
L’H-B – Aujourd’hui où le symbolique défaille et confronte de plus en plus le rapport des hommes et des femmes au réel de la jouissance, avec quels nouveaux symptômes du non rapport sexuel la psychanalyse joue-t-elle désormais sa partie ?
R.-P. V. – Avec la chute des idéaux et la course aux plus-de-jouir pressés, le non rapport sexuel s’est dénudé. Si l’impossibilité de trouver un signifiant de La femme mène à l’impasse du rapport sexuel, c’est l’extension dans la civilisation du non localisable de la jouissance féminine qui amène aujourd’hui à reconsidérer l’impasse de ce rapport : partenaires multiples ou pas de partenaire du tout, communautarisme ou autisme de la jouissance, addictions variées, solitude toujours.
L’H-B – Pouvez-vous repréciser à partir de votre clinique ce qu’il en est de cette substance que la fille attend de sa mère et dont le fond est « ravissement », « rapt »[3]?
R.-P. V. – Une fille attend de sa mère qu’elle lui donne je ne dirais pas légitimité, mais réalité corporelle de femme, mais à poursuivre cette voie elle ne peut qu’y perdre car le réel en jeu dans la corporéité d’une femme ne peut pas se transmettre. Il n’y a pas de « voix du corps »[4]. Le corps de la mère reste étranger, Autre et l’énigme de son désir (que veut-elle ?) redouble l’énigme du réel de son corps. Ce rapt est aussi bien ravage – ravage sans doute différent de celui que révèlent les reproches, déchiffrés par Freud, de la fille à la mère – car ici il y a de l’indéchiffrable. Celui-ci fait les femmes divisées entre sujet parlant et Autre qu’elles sont toujours pour elles-mêmes. C’est là qu’une femme disparaît et c’est le point d’origine du surmoi féminin.
L’H-B – Avec les avancées de la science et le discours du capitalisme, comment la psychanalyse lit-elle les nouveaux rapports symptomatiques que les femmes entretiennent désormais à l’objet a qu’est l’enfant pour elles ?
R.-P. V. – Impossible de répondre brièvement à cela. Disons que les avancées de la science et du marché capitaliste créent des situations absolument inédites dans l’histoire de l’humanité où l’enfant peut venir à être bout de chair que l’on veut à tout prix ou dont on ne veut plus s’il n’est pas conforme à ce qu’on attendait et auquel on ment sur son origine. Cela ne fait que dénuder ce qui était déjà présent : les rejets, les secrets délétères n’ont jamais été épargnés aux enfants. C’est ici que la psychanalyse peut jouer un rôle important.
L’H-B – À l’époque où le symbolique s’efface devant l’exigence surmoïque de la jouissance, que devient, dans la cure, l’inconscient-savoir et comment entendre que depuis, la place de ce qui excède la représentation, le psychanalyste ait à « déranger la défense contre le réel »[5]?
R.-P. V. – Le psychanalyste est pour l’analysant en position de semblant d’objet a cause du désir, objet qui excède la représentation, et c’est comme tel qu’il permet que s’élabore l’inconscient-savoir qui mène un sujet in fine à opérer un renversement du « tout mais pas ça » accompagnant ses débuts d’analyse. Un psychanalyste a aussi éprouvé dans sa propre analyse les limites de l’inconscient-savoir – encore que celui-ci ne soit jamais épuisé – et l’incidence de ce qui excède tout sens, de la marque dernière, inexplicable, d’un dire sur le corps. Dès lors, il ne peut pas renoncer à ce que l’analyse aille jusqu’aux confins de cette défense la plus tenace contre le réel, ce point de fuite qui ne parle pas. Ce moment peut être surprise pour l’analyste lui-même ou même intervenir dans un moment d’outre-passe !
L’H-B – Parce qu’elles se mesurent sans cesse à l’épreuve du pas-tout de leur féminité, les femmes seraient, soutenez-vous, plus à même de « faire refleurir les rameaux de l’amour »[6] à l’encontre du « culte du nom unique »[7] fondamentaliste et du « Un-tout-seul »[8] de l’individualisme. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
R.-P. V. – Les femmes résistent plus que les hommes au nivelage post-moderne de l’individualisme, sans doute parce que leur rapport aux semblants ne peut être uniformisé. Quand elles se font servantes du « culte du nom unique » (jadis, il y eut les « furies de Hitler »[9] révélées par le livre récent de Wendy Lower et, dans un contexte bien différent, on voit aujourd’hui des femmes partir faire le djihad en Syrie), c’est sans doute dans une servitude volontaire à l’égard de leur homme ou pour se forger une identification moins précaire. Si les femmes aspirent à l’amour, c’est pour arrimer ce qui est sans attaches dans la Jouissance Autre qu’elles éprouvent. À cet égard, le lien analytique les intéresse. Et l’amour de transfert ouvre au sujet supposé savoir qui n’est guère complice des semblants mortifères ou intoxicants de la civilisation.
L’H-B – Quelle est la phrase de J. Lacan à propos de la féminité que vous aimez le plus et dont vous aimeriez nous parler ?
R.-P. V. – Peut-être pas celle que j’aime le plus, mais celle qui nous concerne. Lacan dit dans L’angoisse : « Il semble que la femme comprenne très, très bien ce qu’est le désir de l’analyste. »[10] Une femme, en effet, quelque « goût » qu’elle en ait, peut se faire objet cause de désir pour un homme. Et être dans la position d’analyste, c’est, à partir d’une place de semblant d’objet, mener la jouissance à condescendre au désir. Il y a là affinité entre la position féminine et la position analytique. Même si être à cette place, « c’est plus difficile pour une femme que pour un homme, contrairement à ce qui se dit »[11] car il lui faut faire semblant de déchet, silence. Cela n’est bien sûr qu’un des aspects de la question.
[1] Lacan J.,
Le Séminaire, livre X,
L’angoisse, Paris, Seuil, 2004, p. 223.
[2] Lacan J.,
Le Séminaire, livre XXII, « R.S.I. »,
Ornicar ?, Paris, Champ Freudien, n°5, leçon du 11 mars 1979, p. 27.
[3] Vinciguerra R.-P.,
Femmes lacaniennes, Paris, Michèle, 2014, p. 58.
[4] Lacan J., « L’étourdit »,
Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 463.
[5] Miller J.-A., « Le réel au XXIᵉ siècle. Présentation du thème du IXᵉ Congrès de l’AMP »,
La Cause du désir, Paris, Navarin, n°82, 2012, p. 94.
[6] Vinciguerra R.-P.,
Femmes lacaniennes,
op. cit., p. 230.
[7] Ibid., dernier chapitre.
[8] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, leçon du 6 décembre 2006, inédit.
[9] Lower W.,
Les furies de Hitler, Paris, Taillandier, 2014.
[10] Lacan J.,
Le Séminaire, livre X,
L’angoisse,
op. cit., p. 208.
[11] Ces deux dernières citations sont extraites de Lacan J., « La Troisième », texte établi par J.-A. Miller,
La Cause freudienne, Paris, Navarin n°79, p. 16-17.
Lire la suite