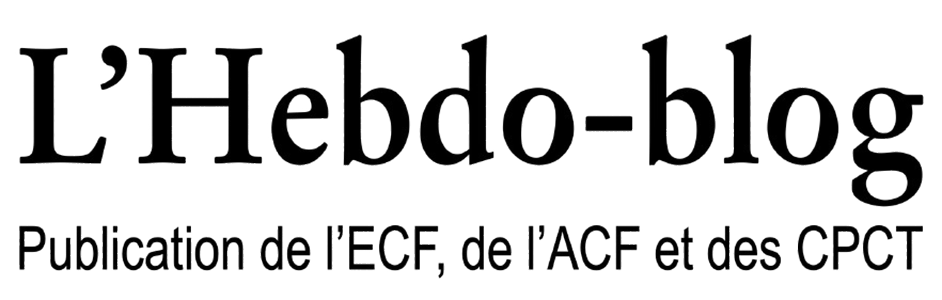Lacan a souvent parlé du transfert. Il y a consacré un séminaire entier, il en a fait un concept fondamental de la psychanalyse dans son Séminaire XI. Il a construit son mathème du transfert en 67, au moment où il invente la procédure de la passe. Mais, à la fin de son enseignement, il n’en parle quasiment plus, voire, il dévalorise le transfert freudien. En fait, il subvertit le transfert freudien pour en proposer une nouvelle définition. Je me propose donc de situer deux scansions du transfert dans l’enseignement de Lacan. Il s’agit des deux textes dans lesquels Lacan définit la procédure de la passe.
La première scansion, se situe au moment où, s’appuyant sur sa définition du sujet, il propose son mathème du transfert dans son texte « Proposition de 67 ». La seconde scansion, je la situe toute à la fin de son enseignement, lorsque Lacan rédige son tout dernier texte, sa « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI ». Le premier texte s’appuie sur la définition du sujet produit dans son Séminaire XI et sur le désir de l’analyste pour élaborer le mathème du transfert, le second ne fait plus du tout état du transfert. Essayons de comprendre pourquoi.
Jacques-Alain Miller fait remarquer que le mathème du transfert dans la « Proposition d’octobre », est l’algorithme de la définition que Lacan donne du sujet qu’on trouve dans le Séminaire XI : « un signifiant est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant » [1]. « La psychanalyse, dit J.-A. Miller, a son départ dans l’établissement minimal, S1-S2, du transfert. […] S1-S2 trouve là une autre écriture, homologue, que Lacan introduit dans sa “Proposition sur le psychanalyste de l’École”. C’est traduire, en termes de signifiants, la relation qui s’établit, conditionnant l’opération analytique. De ce lien, se trouve produit le sujet supposé savoir. Il faut que cet embrayage s’établisse d’un signifiant à l’autre pour qu’il en résulte un effet de sens spécial […] et se trouvent alors mobilisés […] les signifiants dans l’inconscient » [2]. C’est la mise en place de l’inconscient transférentiel. Une analyse démarre avec le transfert freudien dans la mesure où un analysant croit à l’inconscient parce qu’il croit que son symptôme recèle une signification cachée. Le transfert défini à partir du sujet supposé savoir, met en valeur le symbolique et le sujet de l’inconscient.
Le dernier Lacan ne se satisfait pas de la destitution subjective et de la traversée du fantasme à la fin de l’analyse. Cela reste nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que le symbolique ment sur le réel. À la fin de son enseignement, Lacan dépréciera l’inconscient transférentiel. J.-A. Miller parle de déflation du symbolique, le sujet n’est que semblant, et ne se conçoit que dans son articulation à l’Autre. Lacan va donc abandonner le concept du sujet et mettra en valeur le nouage de la langue au corps. L’inconscient transférentiel suppose un savoir, un S2, et fait valoir la dimension de l’Autre. Or une analyse qui s’oriente vers le réel, vise à séparer S1 de l’Autre. Dans sa « Préface à l’édition anglaise du séminaire XI », Lacan ne parle plus du transfert, mais de « cas d’urgence ». Ici c’est le sujet supposé savoir lui-même qui est remis en question. Ici les signifiants savoir, le sujet supposé savoir, et le transfert n’y figurent plus, parce que Lacan « n’y croit plus ». Il s’aperçoit que le transfert freudien ne permet pas de conclure une psychanalyse. Pour être plus précis, l’inconscient transférentiel est second par rapport au réel, à l’inconscient réel qui le précède. Raison pour laquelle Lacan ici parle plutôt d’urgence. L’urgence n’implique pas le lieu de l’Autre. Cas d’urgence, donc, plutôt que transfert. À cet égard, J.-A. Miller souligne qu’il préfère qu’on dise qu’on revient de séance en séance parce que « ça urge », plutôt qu’à cause du transfert. Lacan met l’urgence en valeur précisément pour dissiper le mirage du transfert. « Il y a une causalité plus profonde que le transfert au niveau que Lacan appelle la satisfaction en tant qu’elle est l’urgence et l’analyse est le moyen de cette satisfaction urgente.» [3]
Par le biais de l’association libre, on s’efforce d’interpréter les émergences de l’inconscient, en leur attribuant des signifiants. Faire passer les émergences de l’inconscient dans le symbolique, c’est transformer la vérité de l’inconscient réel en mensonge. L’association libre, joue contre l’inconscient réel. Quand il devient symbolique, il ment. L’urgence de Lacan, c’est celle qui consiste à tenter d’attraper la vérité qu’on n’atteint jamais. C’est la raison pour laquelle, J.-A. Miller peut dire que l’analyse est le moyen de cette satisfaction urgente.
On se retrouve là devant un paradoxe. D’une part une analyse ne peut s’envisager que lorsqu’on mobilise l’inconscient transférentiel, mais d’autre part, l’inconscient transférentiel fait obstacle à l’inconscient réel. Mais est-ce un paradoxe ?
Dans « L’esp d’un laps » Lacan précise que « Quand […] l’espace d’un lapsus n’a plus aucune portée de sens (ou interprétation), alors seulement on est sûr qu’on est dans l’inconscient. » [4] J.-A. Miller met en valeur la coupure que fait valoir ici Lacan, la déconnexion entre S1 et S2. « Nous nous trouvons atteindre, continue J.-A. Miller, à sa jonction le lien du fameux S1 et du fameux S2. […] Cette phrase comporte, si on la lit bien, que S1 ne représente rien, qu’il n’est pas un signifiant représentatif. Cela attaque ce qui est, pour nous, le principe même de l’opération psychanalytique, pour autant que la psychanalyse a son départ dans l’établissement minimal, S1-S2, du transfert » [5].
Une analyse vise à isoler le S1, l’Un tout seul qui est, comme le souligne J.-A. Miller, l’antichambre du réel, la dernière station avant le réel.
On trouve deux occurrences très importantes sur le concept du transfert dans Le Moment de conclure où Lacan précise que ce que l’analyste est supposé savoir, n’a rien à faire avec du savoir, mais ce qu’il sait c’est « comment opérer » [6]. Lacan fait ici référence à l’acte du chirurgien : l’analyste, comme le chirurgien, doit savoir comment couper la chaîne signifiante, entre S1-S2 .[7]
Et plus loin, il ajoute cet éclairage lumineux : « Ce que je dis du transfert est que je l’ai timidement avancé comme étant le sujet supposé-savoir. [Un sujet, dit-il, est toujours supposé, il n’y a pas de sujet bien entendu, il n’y a que le supposé] Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ? » Lacan précise alors que le transfert, « ce n’est autre que le supposé-savoir-lire-autrement. » [8]
Ce sur quoi Lacan met l’accent dans cette phrase où le sujet supposé savoir est dévalorisé, c’est très précisément sur l’interprétation, sur l’acte de l’analyste.
Si l’inconscient transférentiel se met en route avec le sujet supposé savoir et l’association libre, ce que j’écris S1-S2, l’acte analytique visera couper le lien entre S1-S2, soit de produire ceci : S1//S2.
Si l’analysant parle pour produire du sens, l’analyste, tel le chirurgien, coupe. Par la coupure il équivoque sur l’orthographe et en cela son acte participe de l’écriture, faisant résonner par une autre façon d’écrire, « autre chose que ce qui est dit avec l’intention de dire. » [9] Cela comporte que lire autrement demande l’appui de l’écriture. [10]
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre xi, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse [1964], texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, coll. Champ freudien, 1973, p.188.
[2] Miller J.-A., « L’inconscient réel », première leçon du cours [2006-2007] de L’Orientation lacanienne, enseignement prononcé dans le cadre du Département de psychanalyse de Paris VIII., Quarto, n° 88/89, mars 2007, p.7.
[3] Miller J.-A., « La passe du parlêtre », La Cause freudienne, n° 74, Paris, Navarin/Seuil, avril 2010, p. 119.
[4] Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 571.
[5] Miller J.-A., « L’Orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, 2006-2007, inédit. Lire aussi Quarto, N° 88/89, p. 7.
[6] Lacan J., « Le moment de conclure », séance du 15 novembre 1977, Ornicar ?, n°19, Paris, Navarin/Seuil, 1979.
[7] Lire à cet égard l’article remarquable d’Esthela Solano sur le blog du Congrès 2018 de la NLS. Rubrique Portes.
[8] Lacan J., Le Séminaire, livre XXV, « Le moment de conclure », leçon du 10 janvier 1978, inédit.
[9] Ibid., leçon du 20 décembre 1977.
[10] Miller J.-A., Le tout dernier Lacan, Op. cit, Cours du 2 mai 2007, inédit.