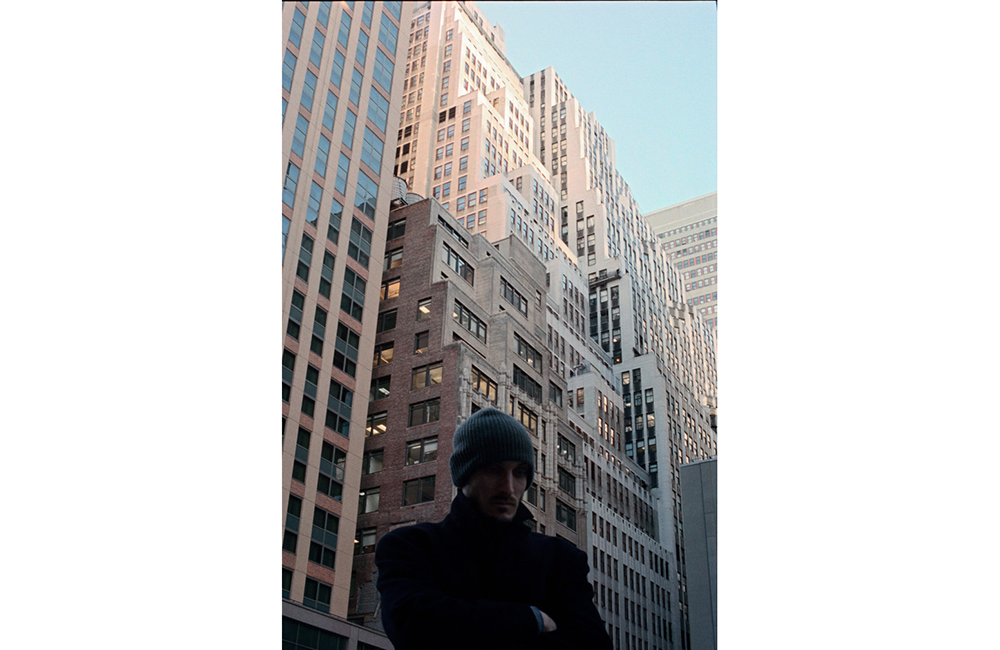La matinée d’étude de l’ACF Rhône-Alpes, qui s’est tenue à Grenoble le samedi 28 février à l’initiative de Délia Steinmann, a fait résonner dans l’histoire ce qui du concept d’inconscient (« drôle de mot » que celui-là) traverse les époques et les discours, à partir des points de rupture d’où a pu émerger l’invention de la psychanalyse. Nicole Edelman, historienne à l’université Paris-Ouest Nanterre, nous a montré comment Freud s’est affranchi subtilement de l’héritage de ses prédécesseurs dont la pluralité des discours dans les études consacrées au somnambulisme magnétique puis à l’hypnose rêvaient d’un inconscient enraciné dans la physiologie (thèse de Ribot 1884). Les précisions d’historien de Freud, telles qu’elles apparaissent dans Die Traumdeutung (1900), s’inscrivent en lien avec les contingences de son temps, mais aussi par rapport au « pas de côté » qu’il fait sur son époque, par quoi il devient possible d’extraire les lois du fonctionnement psychique, les rêves comme voie royale de l’inconscient.
Marie-Hélène Blancard est ensuite intervenue et a mis l’accent sur la façon dont l’inconscient se branche sur le corps et comment Lacan s’est fait l’artisan d’un nécessaire retour à Freud pour réinventer la psychanalyse en passant de l’inconscient jouis-sens (ce que serait le rêve comme rébus) à l’inconscient lacanien qui à la fin d’une cure, procède du vidage de la jouissance. À partir du dispositif de la passe, elle précise comment s’est desserré pour elle l’étau des identifications au corps hystérique qui s’inscrivait comme refus du corps. La tyrannie du savoir convoquait une jouissance absolue, via la figure consistante d’un père absent et une tentative de faire exister La femme par le Un de l’exception. Après le déroulement de la chaîne signifiante, le sujet doit consentir, dit-elle, « à plonger dans le trou du souffleur » dans sa rencontre avec la fonction de la lettre qui fait trou dans le langage. L’inconscient se fait mathème lacanien lorsque la structure se dénude, pas sans le mouvement d’acceptation du corps vivant et la satisfaction de la fin de l’analyse. Cela suppose de s’affranchir de toute idée de guérison qui, avec Lacan, n’advient que par « surcroit ». C’est un beau témoignage sinthomatique donné par celle qui ex-siste comme « bouffeuse de vie », chez qui l’inconscient opère comme discontinuité et non plus comme continuum. Il y a un saut à franchir, un point de rupture à trouver, pour chaque fois arracher un bout de savoir au réel qui, loin d’être la conclusion, se traverse comme un moment de conclure. Tout du réel n’est pas recouvert par le déchiffrement du symbolique.
Entre les deux interventions, un film poétique, réalisé au sein du dispositif « Culture et Santé » du Centre Hospitalier Alpes-Isère par L’Atelier créativité Frantz Fanon et la Compagnie L’Envol, fut projeté : La princesse à la courte mémoire, dont les marionnettes ficellent comme une invitation au rêve, à la magie colorée d’une histoire d’amour où l’inconscient ne demande qu’à se réaliser. Dans sa rencontre avec le désir de l’Autre, la princesse divisée entre le désir de son partenaire et celui du roi ne sait plus très bien sur quel pied danser pour trouver chaussure à son pied. Le conte fait valoir la dimension de ratage du rapport sexuel de chaque être pris dans le papier mâché des chausse-trappes de la jouissance.