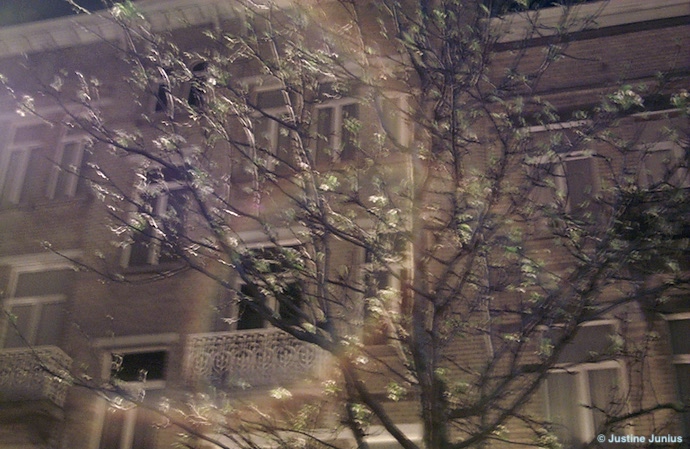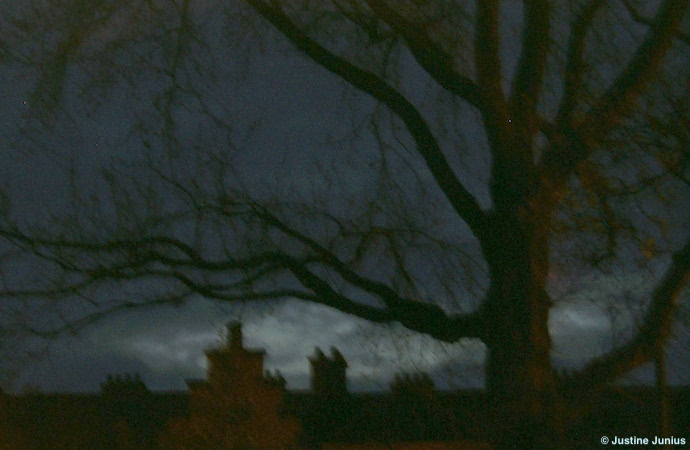La guerre, fait de discours
Conquérante ou défensive, la guerre est considérée depuis toujours comme une activité sociale qui s’impose. Machiavel, en la disant juste, si nécessaire, indique qu’elle ne répond pas à la libération sauvage des instincts ou des pulsions mais à une élaboration qui les encadre. C’est Machiavel qui conseillait au prince de se préparer à la guerre, en levant en masse les citoyens afin de remplacer les mercenaires au service des villes. Sun Tzu ne disait pas autre chose, dans son Art de la guerre. « La guerre est d’une importance vitale pour l’État. C’est le domaine de la vie et de la mort : la conservation ou la perte de l’empire en dépendent ; il est impérieux de le bien régler. » [1] La guerre n’est donc pas hors discours, son caractère se modifie selon la société que colore le discours du Maître en rapport aux autres discours.
Aujourd’hui le concept de réel a fait florès, il s’est glissé dans lalangue. La notion est très communément employée pour signifier ce qui va plus loin que la réalité ou la compréhension, en somme une autre dimension généralement plus dure, voisine du pire.
Produire son réel
Dans le crime contre l’humanité que fut dans la Seconde Guerre mondiale l’entreprise d’extermination des juifs d’Europe, le réel fait son entrée de manière visible, massive et compacte, hors sens et hors discours. Il s’agit d’une entreprise effective de déshumanisation – disparition des corps, des noms, de l’histoire – avec systématisme, exhaustion, rationalisation. La question ici est en effet celle-ci : comment un fou paranoïaque a-t-il pu faire produire à d’autres son réel ? Certes on connaît la puissance persuasive, hypnotisante parfois de celui qui ne doute pas, sur la faiblesse des esprits incertains; ici l’extrême a été atteint et ce qui frappe c’est bien que le réel, celui d’un seul ait été produit socialement dans sa pureté de réel, au-delà de toute imagination possible.
C’est donc bien le réel dans sa monstruosité qui crée un avant et un après dans la conception de la guerre. Au sein de la guerre, celle qui obéit aux lois de la guerre, la possibilité d’une autre guerre est introduite, celle que guide le réel sans loi ou, ce qui lui équivaut, une loi personnelle. Cet absolu du réel réalisé a constitué une fracture dans la civilisation. À partir de là, les formes larvées, où une structure du même ordre se révèle, s’en trouvent éclairées et deviennent lisibles, même si apparaissant comme moins anti-humaine dans leur exécution. Des formes qui vont du crime de guerre au génocide, pour lesquelles le réel comme tel se détache. À l’époque de la jouissance généralisée, elles sont de plus en plus nombreuses, voire participent à toute guerre moderne. La guerre aujourd’hui doit être lue à l’aune du réel en tant qu’il a subverti le symbolique, et partant l’imaginaire, au-delà de la notion de l’alter ego, de l’ennemi.
Du crime réel et de l’imaginaire du groupe
Dans son écrit sur la criminalité, Lacan dessine une place possible pour ce réel bien que non encore théorisé comme tel. Il prend l’exemple de la situation de guerre et du statut du passage à l’acte dans l’armée, armée dont le recrutement est de moins en moins exigeant et sélectif. Eh bien, lors de la mise en contact avec des ennemis civils, une propension pour les exactions apparaît, soit « le goût qui se manifeste dans la collectivité ainsi formée, au jour de gloire qui la met en contact avec ses adversaires civils, pour la situation qui consiste à violer une ou plusieurs femmes en la présence d’un mâle de préférence âgé et préalablement réduit à l’impuissance, sans que rien fasse présumer que les individus qui la réalisent, se distinguent avant comme après comme fils ou comme époux » [2].
La loi symbolique choit dans l’imaginaire que le groupe soutient, en irréalisant l’action du violeur. Le réel s’affranchit du processus d’intériorisation de la pulsion de mort, et si la civilisation devient moins violente, les individus le sont toujours plus. Ils peuvent même se regrouper, se structurer à cette fin. Lacan avait saisi dans son texte sur la psychiatrie anglaise et la guerre [3], dès 1945, le pas pris de l’efficacité du « rapport véridique au réel » côté anglais sur « le mode d’irréalité » côté français [4]. Les « inadaptés, facilement délinquants » et autres « Dullards » regroupés ensemble vinrent, aidés par des psychiatres, grossir l’armée régulière [5]. L’ère du pragmatisme à tout prix avait commencé, les groupes paramilitaires ainsi formés jouent une partie qui reste à explorer.
Examiner le réel : les noms qui peuplent le silence
Être réaliste par rapport à ces nouvelles formes larvées plus ou moins occultes de guerres, c’est d’abord savoir ce que signifie examiner le réel, en apporter la preuve. Il ne relève pas en effet, du simple dire, de la déclaration, et ne s’inscrit dans aucun lien à la vérité.
Dès l’ouverture des camps, Sydney Bernstein, chef de la section film de la division action psychologique des armées alliées, accompagne l’armée. Il est chargé de réaliser un film documentaire. Le film « La mémoire meurtrie, sous-titre témoin à charge » sort en 1945 [6].
Bernstein prend conscience d’emblée que ce qui se présente à lui est tellement inimaginable que l’on pourrait ne pas le croire. Il anticipe en cela les thèses négationnistes : sans la preuve de ce réel, on pourrait réécrire l’histoire. Il note immédiatement que « [l]es images seront insuffisantes en elles-mêmes ». Il faut les insérer dans un discours irréfutable. Il décide, alors, de filmer tout ce qui pourrait prouver que cela s’est passé, noms propres figurant sur les fours crématoires, – « Tous les noms qui peuplent le silence » dit-il –, et tous les autres signes qui font traces signifiantes, pour retrouver les industriels allemands. Interrogations des SS et autres responsables présents : ce qui comptait, c’était de les filmer en présence, les faire « assister à l’enterrement des victimes, voire leur demander de l’aide ». « J’ai demandé des plans séquences aussi larges et longs que possible, et des mouvements de caméra panoramiques ». Il y a associé des images d’autres camps : il ne fallait pas que l’on prenne celui de Belzec Belsen, où il filmait, comme une exception.
C’est à Hitchcock que Bernstein confiera le montage du film, et ce, afin de transmettre la réalité, là-présente à ses yeux où loge l’indicible et monstrueux réel.
Francesca Biagi-Chai
__________________________________
[1] Sun Tzu, L’Art de la guerre, trad. Père Amiot, Paris, Fayard, coll. Mille et une nuits, 2022, p. 5.
[2] Lacan J., « Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 131.
[3] Lacan J., « La psychiatrie anglaise et la guerre », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 101-120.
[4] Cf. ibid., p. 101.
[5] Cf. ibid., p. 105.
[6] Bernstein S., Hitchcock A., La mémoire meurtrie. Memory of the camps, documentaire, 1945.