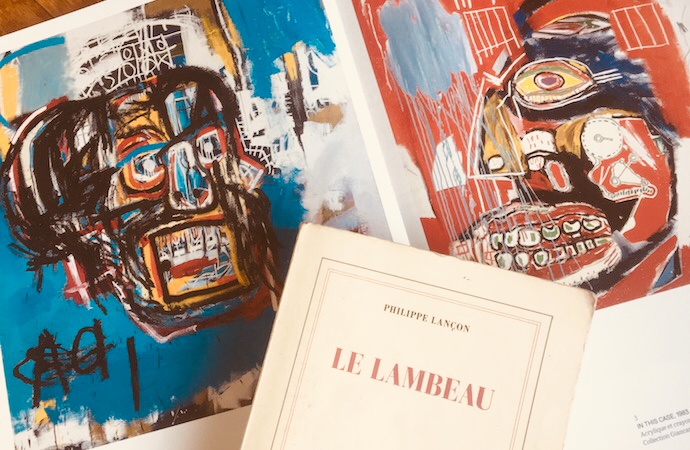« Il est facile de comprendre que la seule présence de sa femme exerçait sur Schreber une influence protectrice contre le pouvoir d’attraction des hommes qui l’environnaient » [1].
Victoria Horne Reinoso : La question de la présence effective de la femme de Schreber comme exerçant « une influence protectrice », trouve pour Freud sa raison d’être dans la thèse qui sous-tend pour lui la paranoïa, celle d’une pathologie qui surgit lorsqu’échoue la défense contre un désir homosexuel [2].
Malgré la finesse de sa clinique, Freud n’avait qu’un seul mécanisme pour penser les névroses et les psychoses : le refoulement. Il explique alors le déclenchement de la paranoïa de Schreber par la présence des désirs homosexuels refoulés, transformés par la projection et faisant retour sur Schreber sous la forme de persécution. Ces désirs pointaient déjà dans le fantasme que Schreber avait eu un peu avant sa deuxième maladie : « l’idée que, ce doit être une chose singulièrement belle d’être une femme en train de subir l’accouplement » [3]. Ce fantasme se mêlait, à l’époque, avec les rêves dans lesquels il tombait de nouveau malade. C’est sur cette association que Freud s’appuie tout d’abord pour avancer que les désirs homosexuels se rapportaient à Flechsig. Au moment où la crainte de retomber malade lui revenait en rêves, Schreber devait, en effet, penser à celui qui l’avait guéri lors de sa première maladie.
Ainsi, nous pourrions effectivement suivre Freud dans sa logique : comme si la présence de sa femme pouvait contribuer à aider Schreber à repousser l’attraction des hommes, lui rappelant sa place d’homme auprès d’elle et contribuant à l’ancrer dans la réalité du lien conjugal. Cependant même dans cette logique, l’affirmation pourrait être contestable…
Mais comment pourrions-nous penser cette question si nous prenons les perspectives de Lacan ?
Freud lui-même, à la fin du cas, fait un pas supplémentaire concernant le type de « refoulement » dont il s’agit pour Schreber. Il montre qu’au lieu de dire « ce qui a été réprimé au-dedans fut projeté au-dehors », il faudrait penser que « ce qui a été aboli au‑dedans revient du dehors ». C’est l’un des passages qui permet à Lacan d’extraire le terme Verwerfung à partir duquel il construira sa théorie de la forclusion du Nom-du-Père « qui donne à la psychose sa condition essentielle » [4].
En ce qui concerne la supposée homosexualité refoulée, le Lacan de « D’une question préliminaire… », montre qu’il faut percevoir cette forclusion afin, dit-il, de « saisir la chaîne où se trament les agressions érotiques éprouvées par le sujet, et de contribuer par là à mettre à sa place ce qu’il faut appeler proprement l’homosexualité délirante » [5] de Schreber.
Ce défaut symbolique produit par la forclusion du Nom-du-Père, P0, implique une non opérativité de la signification phallique qui a comme conséquence une « dévirilisation ». Cela pousse Schreber du côté d’une féminisation délirante se traduisant sur le plan imaginaire par un déploiement de pratiques transsexualistes. Schreber se regarde dans le miroir paré d’attributs féminins dans un rituel où il s’habille, se fait femme, se regarde.
Mais la féminisation est aussi une tentative de localiser une jouissance en excès qui le déborde sans trouver de limite pour parer à l’invasion pulsionnelle. Freud pressent cet aspect en précisant qu’il s’agit d’une homosexualité « particulière », qui n’est pas véritablement « élection d’objet » mais l’irruption d’une poussée libidinale qui le déborde et l’oblige à être dans la volupté en permanence.
En revanche, « être La femme de Dieu » désigne une place, une place d’exception. Dans « D’une question préliminaire… », c’est ce que Lacan formule avec la phrase : « faute de pouvoir être le phallus qui manque à la mère, il lui reste la solution d’être la femme qui manque aux hommes » [6].
Mais c’est après avoir élaboré les formules de la sexuation qu’il donnera un nouvel éclairage, s’éloignant davantage de l’hypothèse freudienne de la paranoïa comme échec des défenses contre des pulsions homosexuelles, et apportant également une nouvelle dimension à la question de l’exception.
C’est dans « L’étourdit » que Lacan avance le concept de « pousse-à-la-femme » [7] pour rendre compte de la position de Schreber. Le pousse-à-la-femme n’est pas un phénomène et ne se superpose donc pas tout à fait à la féminisation. C’est un concept qui a une structure logique en rapport avec la pulsion, s’inscrivant dans la logique des formules de la sexuation. C’est un effet déchaîné par le déclenchement psychotique qui met le sujet face à l’absence de signification phallique.
« L’irruption de Un-père comme sans raison » du déclenchement, bouleverse l’aménagement qui permettait à Schreber de tenir. L’afflux d’une jouissance non corrélée au phallus précipite l’effet de féminisation.
Dans une première phase du délire, Schreber a la conviction d’un « complot » orchestré par Flechsig, visant à changer son corps en un corps de femme afin d’abuser de lui sexuellement. Être une femme quelconque, abusée par des hommes, même Flechsig, reste non seulement inacceptable, mais hors-sens. Cela ne lui permet pas de contenir la dérive.
Il multiplie les efforts pour construire une version du délire plus soutenante et digne. Être La femme de Dieu, ayant pour mission d’engendrer une nouvelle race d’hommes, n’est pas seulement plus acceptable pour Schreber, mais le pousse-à-la-femme comme place d’exception, lui permettra surtout de poser une limite à l’envahissement de jouissance. Le délire à profusion devient alors ce que Lacan appelle une « métaphore délirante » stabilisant sa psychose.
Alors, une fois déconstruite l’hypothèse freudienne de l’émergence des pulsions homosexuelles dans la paranoïa de Schreber, la question de l’incidence de l’influence protectrice de sa femme contre l’attraction des hommes n’a plus le même sens. Cependant, nous pouvons nous poser la question de l’existence d’une autre sorte d’influence protectrice de sa femme.
La finesse de la remarque de Freud s’appuie sur la façon dont Schreber témoigne de ce moment critique. Mais est-ce que le départ de sa femme a pu avoir une incidence sur le mouvement qui le faisait sombrer dans ce moment de mort subjective ? Sa manière d’en rendre compte nous indique au moins l’importance de la place que sa femme occupait pour lui jusque-là. Nous pourrions alors faire l’hypothèse que si la présence effective de Sabine n’aurait pas pu tempérer les effets de la rencontre du trou de la signification phallique, sa femme était néanmoins un élément fondamental du nouage qui soutenait Daniel Paul dans sa vie. Cependant son influence protectrice a trouvé une limite dans la structure de la psychose de Schreber et dans les contingences qui se sont présentées à lui sur son parcours.
______________________
Philippe La Sagna : Le 5 févier 1878, Daniel Paul Schreber épouse à Leipzig, Ottilie Sabine Behr. Elle a quinze ans de moins, son père, ancien chanteur, dirige un Théâtre. Ce n’est pas un beau mariage, surtout pour la mère de Daniel Paul Schreber. Entre la première maladie de Schreber et la seconde, il y eut huit années de bonheur conjugal « assombries » par les quatre fausses couches de son épouse. Mais en novembre 1893, Schreber rechute et il est hospitalisé dans un état délirant. Le 15 février 1894, la femme de Schreber qui passait plusieurs heures par jour à la clinique avec lui, entreprend un voyage de quatre jours à Berlin « chez son père pour s’accorder quelques délassements dont en effet elle avait grand besoin ». Schreber tombe très bas pendant ces quatre jours. Et à partir de là, les visites cessent, semble-t-il, à la demande de Schreber qui veut épargner à sa femme le spectacle de sa chute. Mais il ajoute, lorsqu’il aperçoit Sabine de temps en temps, « je ne crois plus voir en elle un être vivant, mais seulement une de ces formes humaines dépêchées là par un miracle », image humaine « bâclée à la six-quatre-deux ». Schreber eut des pollutions nocturnes multiples pendant les nuits d’absence de sa femme à Berlin. C’est ce qui, pour Freud, signe l’homosexualité du sujet, facilitée ici par l’absence de la protection de Sabine. Or ce phénomène survient, semble‑t-il, après que cette transformation de la réalité de sa femme se soit réalisée ? Aussi doit-on se méfier de comprendre un peu trop vite comme peut le faire Freud : « Il est facile de comprendre que la seule présence de sa femme exerçait sur Schreber une influence protectrice contre le pouvoir d’attraction des hommes qui l’environnaient. » [8]
Freud, après avoir évoqué le rôle de l’andropause dans l’apparition de l’homosexualité du Président, situe l’origine de cette tendance dans son transfert sur le professeur Flechsig. Dieu va ensuite remplacer Flechsig, mais à la condition que s’opère la féminisation du sujet. Quant à madame Schreber on peut dire qu’au cours de la deuxième hospitalisation, sa disparition, n’est pas uniquement délirante ; Sabine ne lui faisait, en effet que des visites épisodiques « espacées de plusieurs mois » [9]. Ce qui dérangeait à peine Daniel Paul car, comme il nous le confie, « il y avait en effet bien longtemps que je ne la croyais plus de ce monde » [10]. Lorsqu’elle réapparait, parfois, il se trouve « devant une énigme non résolue », celle de la présence vivante de Sabine. Ce qui rend la réalité de Sabine Schreber encore plus énigmatique c’est qu’en effet, auparavant Schreber a senti les nerfs de sa femme approcher de son corps à lui. Schreber peut faire, en effet, habiter dans son corps des nerfs appartenant à d’autres, donc aussi à sa femme. Ces nerfs sont aussi des « fractions d’âmes », « toutes entières emplies de l’amour dont de tout temps, ma femme a témoigné à mon égard ; elles étaient les seules à faire connaître par le « laissez‑moi » (expression de la langue fondamentale…) leur renoncement délibéré de toute espèce d’autonomie et leur volonté de trouver dans le corps de Schreber l’achèvement de leur existence ».
Schreber use donc de sa femme pour alimenter sa féminisation, non par identification imaginaire, mais bien par une absorption réelle de la jouissance Autre et, aussi bien, par une assomption de la condition mortelle, sociale féminine et assujettie de Sabine. Vu ainsi, madame Schreber n’est pas vraiment protectrice de la féminisation de Schreber mais involontairement sa complice. De même, si Schreber envisage l’éviration qui est sa transformation en femme comme un « compromis raisonnable » ce n’est pas uniquement en tant que son union avec Dieu lui donne de l’importance et serait ainsi compensatrice narcissiquement. C’est plutôt que « le genre humain sous ses espèces réelles, avait disparu de la surface de la terre » [11]. Pour le sujet, comme les hommes ne sont plus que des ombres d’hommes, parmi lesquelles figure donc madame Schreber, alors l’éviration ne constitue plus une « infamante humiliation » [12]. Les rayons avaient beau accabler Schreber saisi par la volupté d’âme, en lui disant « devant votre épouse vous n’avez pas honte » cela ne changeait pas grand‑chose, puisque Sabine n’était plus une créature aussi réelle que dans la vie. C’est donc en pleine conscience que Schreber « inscrit sur ses étendards le culte de la féminité ». C’est, qu’au passage, s’il devient femme c’est une femme saine d’esprit. Sa féminisation le protège de pire, soit de perdre vraiment la raison ! Schreber choisit de se consacrer à la féminité. S’il ne peut avoir une femme, il peut l’être ! C’est ce qui lui permet d’accéder à une « condition corporelle supportable »[13], soit de se faire un corps de jouissance par emprunt de la jouissance féminine de son épouse. Certes, Schreber s’inquiète de l’effet produit par sa transformation sur Sabine à qui il conserve entièrement « l’ancien amour ». Il sait qu’il est difficile pour sa femme de « conserver l’amour et la prévenance du passé quand elle entend que je suis tant préoccupé de l’idée de ma transformation possible en femme ».
Il faut aussi mesurer que Schreber doit mettre en avant dans ses Mémoires qui sont une supplique pour justifier sa sortie, son amour pour sa femme et la ménager, car une des raisons de son interdiction et de son maintien à l’asile, pour les experts, est le risque qu’il détériore au dehors les relations avec son épouse. Par contre il reconnaît que la vie conjugale avec sa femme est « absolument inexistante ». Schreber, toujours prudent, ajoute que « c’est toujours à contre cœur que je lui ai montré mes parures de femme, lorsqu’avec une curiosité féminine bien pardonnable, elle insistait pour les voir. » Madame Schreber, de fait, supportait beaucoup plus mal les hurlements de son mari que son délire transsexuel. Il faut noter aussi que Schreber ne lâche jamais rien sur la réalité de la féminisation, même à son détriment, car il en fait la pierre de touche de son délire, il veut faire constater cette transformation par la science, comme effectivement réelle.
Lacan, dans le schéma I des Écrits [14], montre comment la réalité se maintient pour Schreber. Lacan fait un parallèle sur son schéma I entre les deux lignes qui bordent et limitent la dimension de la réalité. En haut du schéma, la ligne supérieure est désignée dans le fait que Schreber s’adresse à nous – nous qui lisons les Mémoires – et à sa femme, à qui ils étaient aussi dédiés. En bas, le fait que Schreber aime sa femme constitue l’autre bord de la réalité. Lacan souligne que tout cela ne nous dit pas ce que nous sommes pour Schreber, « ni sur ce qui demeure de sa relation à sa femme »[15]. Si on peut suivre Lacan lorsqu’il met en avant un amour amitié de Schreber pour sa femme, nous avons vu qu’en réalité elle représente autre chose qu’un semblable. En tant que la jouissance féminine de Schreber participe de la féminisation de Schreber, sa femme a un pied dans le réel. Ce réel se confirme par le caractère problématique de la réalité humaine de Sabine pour le sujet. Ce n’est pas de la libido homosexuelle que madame Schreber protège son mari, c’est plutôt qu’elle lui donne, à la fois, une figure possible de sa jouissance féminine et une part de cette jouissance. Que dans le schéma de Lacan, sa femme soit aussi du côté de la parole va bien avec le « tu es ma femme » comme formule du mariage. Si, par contre, on réalise un recollement du schéma de Lacan, pour faire de la bande de la réalité une surface de Moebius, on s’avise en effet alors du lien indissociable entre le « s’adresse à nous » en haut et le « aime sa femme » en bas. Et dans ce cas, ce qui est à retenir c’est le fait crucial pour Schreber d’être entendu, de participer à une conversation où l’amour conjugal est impliqué. Lacan dans son Séminaire du 8 avril 1975 souligne que ce que démontre la paranoïa du président Schreber c’est qu’il n’y a de rapport sexuel qu’avec Dieu. Il ajoute : « C’est la vérité ! Et c’est bien ce qui met en question l’existence de Dieu, nous sommes là dans un raté de la création (…). »[16]
Si le rapport sexuel est possible dans la psychose, c’est avec Dieu et alors c’est Dieu qui est problématique ! Donc l’autre conjugal est un moyen de se passer soit du rapport, soit du grand Autre, c’est donc une voie laïque !
[1] Sigmund Freud S., « Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de paranoïa », (1911), Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 2003
[2] Duetto lors des 48e Journées de l’ECF, le 16 novembre 2018.
[3] Schreber D. P., Mémoires d’un Névropathe, Paris, Seuil, Point, 1975, p. 46.
[4] Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 575.
[5] Ibid., p. 580.
[6] Ibid., p. 566.
[7] Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 466.
[8] Freud S., « Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de paranoïa », op. cit., p. 293.
[9] Schreber D. P., Mémoires d’un névropathe, Paris, Seuil, Points, 1985, p.109.
[10] Ibid.
[11] Ibid. , p. 151.
[12] Ibid.
[13] Ibid. , p. 152.
[14] Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », op. cit., p. 571.
[15] Ibid., p. 51-52.
[16] Lacan J., Le Séminaire, livre XXII, « R.S.I. », leçon du 8 avril 1975, Ornicar ?, Paris, Navarin, hiver 1975/1976, n° 5.