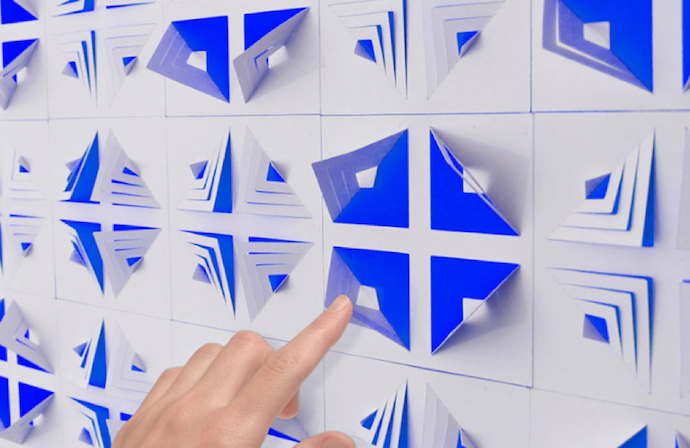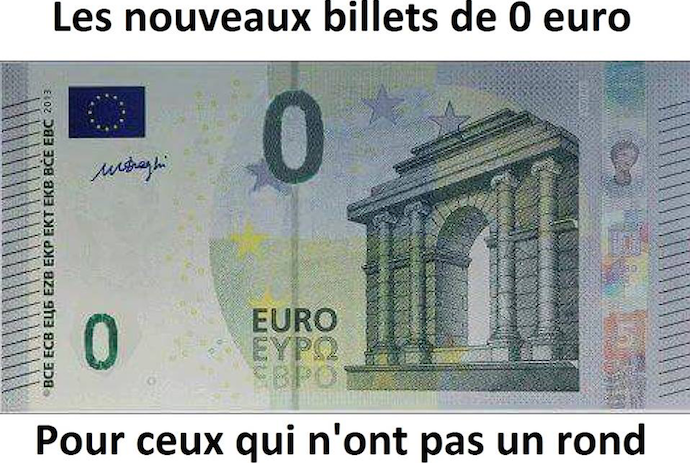Freud a toujours cherché à fonder une clinique propre aux concepts psychanalytiques. La distinguant de la clinique purement psychiatrique[1].
Les types cliniques freudiens ne se déterminent ni au regard des phénomènes, ni des symptômes. Ils se fondent en fonction des modalités de défense, de localisation et des formes d’investissement de la libido. Jacques-Alain Miller déplie cela dans son texte « Schizophrénie et paranoïa »[2].
Lacan emboîte ce pas, en extrayant du corpus freudien une modalité de refoulement propre aux psychoses : la forclusion. Après avoir inscrit la subjectivité humaine dans le rapport au signifiant, il approfondit la voie freudienne en traduisant le concept de libido par celui de jouissance. Il réintroduit ainsi le statut du corps – en tant qu’il y a un désaccord fondamental entre le vivant et le sujet comme effet du signifiant. Pour reprendre la formule : « un désordre […] au joint le plus intime du sentiment de la vie »[3].
Ce désordre vaut pour tous. Il signe une forclusion généralisée. La jouissance n’est jamais la bonne. Elle vient toujours en excès, ou en défaut. Dans l’orientation lacanienne, nous déterminons des types cliniques quant à la façon dont chacun se débrouille avec ce désaccord de structure, trouve à y donner sens et signification – ou pas.
La schizophrénie nous enseigne un paradigme de la jouissance – J.-A. Miller y attire notre attention[4]. À savoir, que la jouissance n’est, a priori, pas sexuelle. C’est ce que cerne le concept lacanien d’objet a. Fidèle à Freud, la jouissance première du corps est auto-érotique. Foncièrement, elle est asexuée.
Les phénomènes schizophréniques montrent, à ciel ouvert, une « jouissance pure et désarrimée de l’objet petit a »[5]. Le corps pouvant se vivre comme morcelé et ses manifestations de vivant animées d’une volonté certaine, bien qu’énigmatique au sujet. Le sujet en est alors la proie, sans recours à un discours pour y donner sens et fonction. Ce vivant désaccordé peut se localiser dans des endroits du corps qui démontrent que cette jouissance n’est, en soi, pas sexuelle – les cheveux par exemple, pour ce jeune enfant qui devait, dès lors, se les couper frénétiquement pour que leur vivant cesse, un temps, de l’assiéger.
Ce n’est que par une opération complexe que la jouissance asexuée de l’objet a peut trouver à s’éprouver comme sexuelle – se localisant et se coordonnant alors au phallus. L’organe pénien, que le phallus représente, remplissant par sa fonction biologique de tumescence‑détumescence la condition propre à incarner l’organe de la jouissance. Il confère une dimension à éclipse, à la pulsion, et la limite. Lacan démontre que cette opération répond d’une logique de la métaphore – c’est elle qui donne signification sexuelle[6].
À la situer dans le cadre de la mythologie œdipienne, c’est la métaphore paternelle, phallique, qui donne sens, signification sexuelle et localisation à une jouissance d’abord énigmatique et hors sens, incarnée par la présence-absence de la mère. C’est une métaphore, parce qu’elle substitue le signifiant et la signification phallique à un désir dont la signification est d’abord inconnue.
Cette opération articule la question du désir et de la jouissance dans un réseau sémantique et une trame signifiante complexe, qui produisent une surdétermination des symptômes.
Quand la métaphore paternelle est inopérante, la libido cesse d’être attirée et concentrée dans la signification phallique. Elle se disperse alors dans différentes localisations douloureuses du corps, provoque une série d’événements désordonnés en son sein, voire se trouve concentrée dans l’ensemble de l’être du sujet : ce que Schreber qualifie du nom de volupté d’âme[7]. Son travail d’élaboration délirante, consistant à traiter cette jouissance désarrimée par une métaphore de substitution, qui donne une signification sexuelle nouvelle aux phénomènes de jouissance qui assiègent le corps : être la femme de dieu.
Épinglons quatre propositions par rapport à cette logique.
1/ La clinique a démontré le caractère toujours incomplet, en défaut, de la métaphore qui sexualise. Elle laisse toujours place à des restes de pulsions partielles qui ne s’y résorbent pas, et réitèrent en tant que jouissance opaque. Précisément, ce que Lacan épinglera d’objet a. La logique de la métaphore ne lui sied pas. Il est précisément, dans sa métonymie, ce qui y échappe.
2/ La forclusion du signifiant qui capitonne la signification sexuelle de la jouissance, ne doit pas oblitérer qu’elle répond et est « corrélative d’une décision de l’être, c’est-à-dire d’une position subjective »[8]. Celle-ci consiste d’un rejet, d’une incroyance et d’un ravalement au rang d’imposture de la métaphore paternelle.
3/ Ce rejet, cette incroyance, et ce ravalement sont précisément les marques où se reconnaît la subjectivité de l’époque. Elle touche de plein fouet le statut du père et du phallus, pour en contester, le primat. Il n’est qu’à voir les difficultés auxquelles se trouvent plus que jamais confrontés, dans leur assomption sexuelle, les garçons qui ont encore choisi d’en emprunter les voies.
4/ Signe des temps : s’y ajoute un rejet de la métaphore en tant que telle, au profit de la métonymie. Le champ de la pratique de la parole en est impacté. Même le champ du sexuel se trouve aujourd’hui désinvesti du registre de la métaphore. C’est ce que pointait J.-A. Miller : la dimension de vacuité sémantique de la pornographie contemporaine où s’atteint désormais, épinglait-il, un zéro de sens[9]. Point de détour par des signifiants substitutifs. Chacun revendiquant son droit à l’accès en direct aux modes de jouissance de l’objet partiel, qui ne souffrent plus de différenciations et de hiérarchisations, tous renvoyés aux rangs de semblants illégitimes et discriminatoires.
Les conséquences de ces quatre propositions touchent à la logique qui déterminait nos types cliniques. Les voies de la névrose se font de moins en moins typiques. Libérées du joug identificatoire du primat du phallus, elles ne constituent plus la norme mais un choix de jouissance, comme un autre, voire obsolète : jouir de l’interdit.
Identifiés à leur jouissance, les sujets, toujours d’aujourd’hui, voient le devoir d’invention du psychotique se généraliser. Plutôt, s’ordinariser. À l’ère de la contestation de la consistance de l’Autre, le corps des parlêtres est « laissé à l’abandon par les normes »[10]. Il devient « le siège d’invention qui tendent à répondre à la question « Que faire de son corps ? »[11] Piercing, tatouages, Body art, dictature de l’hygiène, activités sportives, y compris extrêmes, addictions généralisées, recours multiples à la chirurgie, diététiques nouvelles sous toutes ses formes, pratiques sexuelles qualifiées auparavant de perverses, et dorénavant rangées au rang d’ « expériences » possibles et d’identités reconnues – telles en sont les marques et les nouvelles modalités de symptômes.
Joyce a ouvert une ère nouvelle pour la psychanalyse. Il a démontré, par son art, la capacité de prise en charge de ces jouissances – que dans notre logique nous pouvons dire de plus en plus asexuées, y compris dans les pratiques sexuelles –, par un travail de la langue, qui se passe du sens et de la métaphore[12]. Aux prises de ce travail inventif de reconfiguration, le parlêtre convoque de nouveaux types identificatoires qui produisent un « recodage »[13] en communautés spécifiques. Nous tâchons, avec les concepts dont nous héritons de Lacan, d’en élucider la logique clinique.
[1] Intervention au XIe congrès de l’AMP à Barcelone « les psychoses ordinaires et les autres, sous transfert », avril 2018.
[2] Miller J.-A., « Schizophrénie et paranoïa », Quarto, n° 10, février 1983, pp. 10-38.
[3] Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 558.
[4] Miller J.-A., op.cit.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Lacan J., op.cit.
[8] Miller J.-A., « Sur la leçon des psychoses », 1987, L’expérience psychanalytique des psychoses. Actes de l’École de la Cause Freudienne, Vol. XIII, Paris, ECF, 1988.
[9] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant » – présentation du thème du Xe congrès de l’AMP à Rio en 2016, Scilicet – Le corps parlant, sur l’inconscient au XXIe siècle, coll. rue Huysmans, Paris, 2015, p. 24.
[10] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’expérience du réel dans la cure analytique », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, leçon du 16 juin 1999, inédit.
[11] Ibid.
[12] Il est intéressant de noter que Lacan dit que par son art, Joyce métaphorise… son corps. Ulysse le fait ouvertement.
[13] Ibid.