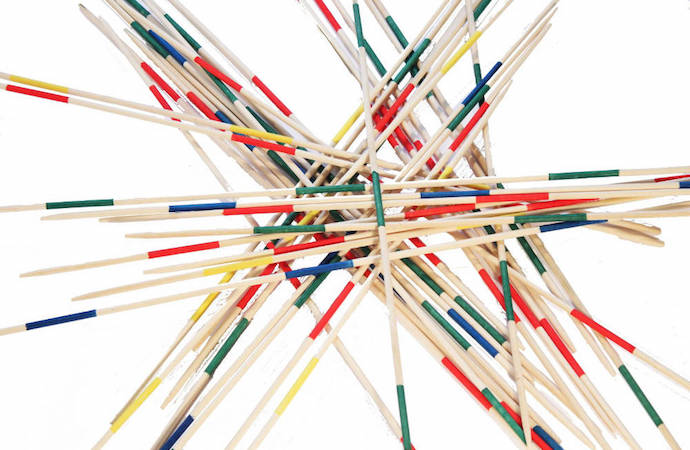Le moment d’urgence des dernières élections présidentielles avait imposé de sauter directement de « l’instant de voir » au « moment de conclure ». Un temps d’élucidation s’ouvre maintenant, dans l’après-coup du pas politique effectué en 2017 par l’École de la Cause freudienne. À mon sens, celui-ci invite à opérer un aggiornamento concernant la conception du désir de l’analyste dès lors qu’on y implique désormais une dimension politique.
L’idée selon laquelle les analystes auraient à « ne pas prendre parti » trouve à s’enraciner dans certaines élaborations de Lacan quant à la spécificité de la psychanalyse et du désir de l’opérateur qui soutient l’existence de cette praxis.
Dans son combat contre l’Ego psychology ou les tenants de la relation d’objet, Lacan avait critiqué vertement les prêcheries moralisantes des analystes qui faisaient de leurs idéaux et préjugés « la mesure dernière à quoi est sollicitée de se rallier [1] » le sujet. Il les enjoignait plutôt à se dépouiller via l’analyse de leur système de valeurs adossé au fantasme et faisait du désir de l’analyste une fonction universelle à prendre « au sens générique [2] ». L’analyste était tenu de se défaire de ses particularités, d’offrir sa place comme vacante, « pour s’inscrire sous cette catégorie [3] ». De là les différentes modalités par lesquelles Lacan a représenté cette ascèse de l’analyste au-delà des jouissances ordinaires du narcissisme ou du « service des biens ». Lacan cherchait à distinguer la position de l’analyste de toute stature de maîtrise. Ce dernier doit viser à déchoir de la place d’idéal pour incarner plutôt l’objet a cause du désir [4].
À la fin des années 60, Lacan situa le désir de l’analyste comme tenant lieu de ce qui manque au champ de l’Autre et semblant d’objet [5]. L’idée de « neutralité de l’analyste » semble dès lors s’imposer du fait que l’analyste n’occupe pas une place de sujet dans la relation analytique, mais d’objet.
De plus, le dispositif analytique paraît reposer sur la suspension de toutes les valeurs et de toutes les normes. Lacan parvient ainsi dans son Séminaire VII à réaliser l’exploit de concevoir une éthique sans normes, a-normative. Il se donne pour projet de penser une éthique psychanalytique sans obligations, qui ne dicte ni n’édicte rien : « Une éthique s’annonce, convertie au silence, par l’avenue non de l’effroi, mais du désir [6] ».
Aux alentours de Mai 68, Lacan poursuit avec sa théorie des discours sa tentative de fonder l’irréductibilité de la psychanalyse et pose une différence radicale, logique, entre le discours analytique et les autres discours [7]. Les psychanalystes sont incasables dans aucun des discours précédents, leur praxis se tient en dehors, « ex-siste », aux autres formes de pratiques et de savoirs [8]. Lacan a situé à ce moment-là la psychanalyse à « l’envers du discours du maître » et donc à l’envers de la politique.
Nuançons maintenant cette approche du désir de l’analyste. À la fin du Séminaire XI, Lacan est lui-même obligé de reculer face à la monstruosité qu’il s’apprêtait à engendrer : la tentation de considérer le désir de l’analyste comme « un désir pur [9] ». Il n’est pas un désir pur car, à moins d’être Spinoza et d’atteindre à la béatitude dans l’amour intellectuel de Dieu (ce qui n’est certes pas donné à tout le monde !), la règle générale est que le désir pur serait un désir détaché de l’objet a. Et même – Lacan le montre dans son « Kant avec Sade » – un désir qui aurait procédé à sa purification par le sacrifice, le meurtre de son objet [10]. « […] ce désir à l’état pur, ce désir de rien, est un autre nom de la pulsion de mort. […] ça ferait de l’analyste rien d’autre que le gardien ou le servant de la pulsion de mort [11] ». Or, ce que vise le désir de l’analyste c’est l’assomption de l’objet du désir par l’analysant et non pas son sacrifice.
L’analyste prend parti pour la cause du désir, toujours marquée d’une certaine « déviance » relativement au « contexte social [12] ». Le psychanalyste est un militant du symptôme singulier, intrinsèquement subversif relativement au carcan social. Par sa diffusion dans le corps social, la psychanalyse a fait au XXe siècle de la politique sans le savoir, mais nous avons expérimenté lors des débats sur « le mariage pour tous », que la psychanalyse avait une responsabilité politique désormais consciente d’elle-même dans la transformation des normes sociales afin qu’elles fassent droit aux normes subjectives dans leur diversité.
Lacan, tout au long de son enseignement, s’est efforcé de penser les « conditions de possibilité » de la psychanalyse comme discours non normalisant et pratique hors normes : les conditions logiques, techniques, éthiques. L’heure est venue d’en penser les conditions politiques de possibilité. Concernant le désir de l’analyste, il ne faut pas oublier les contextes historiques dans lesquels Lacan a déployé ses conceptions successives. Dans les années 50, il bataillait explicitement contre les normes et les idéaux véhiculés par les praticiens de la psychanalyse. Au tournant des années 60-70, c’est dans un moment historique précis d’ébullition politique, de foisonnement des idéaux et des utopies, que Lacan a martelé l’idée de la psychanalyse comme « contre-point » de la politique. Notre moment historique est différent et appelle des réponses différentes.
Certes, du point de vue de la structure, le discours de l’analyste reste et restera toujours l’envers du discours du maître. Néanmoins, notre contexte politique particulier nous pousse aujourd’hui à mettre l’accent sur un autre aspect du désir de l’analyste et à le dépeindre non plus seulement négativement – comme désir qui ne jouit pas – mais positivement : comme désir qui porte et soutient un discours, non seulement dans les cures, mais dans le champ social et politique. Le désir de l’analyste se situera toujours à contre-courant de tout endoctrinement ou suggestion que ce soit, mais il est politique en ce qu’il est foncièrement engagé au service du désir singulier, en ce qu’il est désir de désir.
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, La Martinière / Le Champ freudien, 2013, p. 557-558
[2] Cottet S., « Avant-propos de la seconde édition », Freud et le désir du psychanalyste, Paris, Seuil, 1996, p. II.
[3] Ibid., p. III.
[4] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, 1973, chapitres XIX et XX.
[5] Cf. Cottet S., Freud et le désir du psychanalyste, op. cit., p. 184
[6] Lacan J., « Remarque sur le rapport de Daniel Lagache », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 683-684
[7] Cf. par exemple Lacan J., « Intervention aux « conclusions des groupes de travail » », Lettres de l’École Freudienne, 1975, n°15, pp. 235-244, disponible sur internet.
[8] Lacan J., « Introduction à l’édition allemande d’un premier volume des Écrits », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 555.
[9] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts…, op. cit., p. 307.
[10] Ibid., p. 306.
[11] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le banquet des analystes » [1989-90], enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, leçon du 28 mars 1990, inédit.
[12] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, op. cit., p. 566.