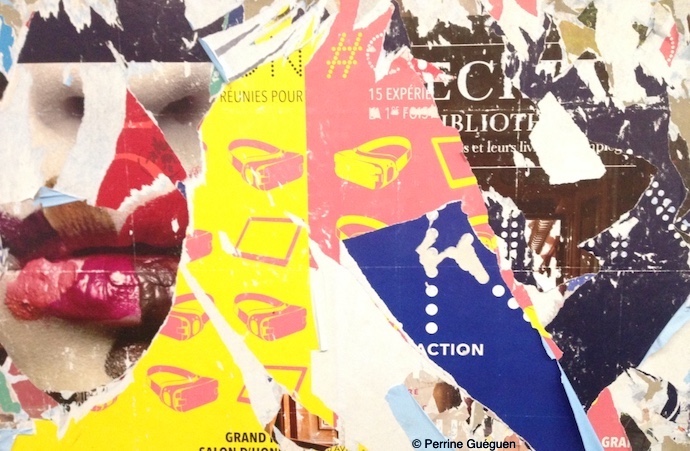Je suis ce que je dis se pose comme une assertion de certitude refermée sur elle-même. À la différence de l’assertion de certitude anticipée [1], elle ne définit pas une hypothèse logique, qui serait à vérifier dans l’après-coup d’un acte. L’assertion je suis ce que je dis nie la dimension du temps qu’il faut pour comprendre, pour arriver immédiatement au moment de conclure. Elle ne suppose pas un tu peux savoir. Elle méconnaît ou forclôt ce qui ne vient pas au dire, ce reste insu qui joue sa partie autonome et se révèle dans les dessous, et dans le faire. La jouissance fixée agit en silence, dans la contingence d’un signifiant qui ne voulait pourtant rien dire d’elle : « qu’on dise, reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend » [2]. Le reste insu reste muet et passe au corps, où il s’écrit dans une autre langue : celle de l’exil de la jouissance en tant qu’exclue du symbolique. La séance analytique permet de repérer ses échappées dans l’équivoque, dans le lapsus, l’acte manqué et dans le rêve. L’énoncé je suis ce que je dis ne se prête pas à l’expérience analytique : il y a peu de chance de repérer la fixation de jouissance en dehors de la cure et encore moins de permettre au sujet d’obtenir quelques lumières sur son rapport à l’objet qui reste insaisissable. L’itération du franchissement dans le passage à l’acte, du débordement dans l’excès ou la douleur, la répétition d’un ratage, toujours le même, dévoilent cette absence de rapport entre le dit, le dire et l’être, mais à la condition d’être interprétés. L’angoisse qui les accompagne est ce qu’il y a de plus sûr, le signal d’un écart, d’un gap comme on dit, entre le quai et le marche-pied, quand on descend du train. Je suis ce que je dis est un énoncé qui peut priver le sujet de toute possibilité d’advenir. Réel forclos, inconscient nié, circulez : si tout est dit, il n’y a plus rien à voir, ni à savoir. Au-delà de la pratique clinique, l’ensemble de nos pratiques professionnelles individuelles et institutionnelles se trouvent concernées, affectées par cette nouvelle dimension de la parole. Lors des J52, la journée consacrée aux simultanées cliniques [3] permettra d’entendre la diversité des situations dans leur singularité.
Car un Congrès dans l’orientation lacanienne, c’est un lieu, un moment, une rencontre avec le point où chacun en est sur une question cruciale. Il y a toujours, à partir d’un concept qui se dévoile de façon inédite, un retour sur sa pratique d’analysant ou sur sa pratique d’analyste ou sur le passage, la passerelle, de l’une à l’autre. L’interprétation du rêve ne tient qu’à une apostrophe, par exemple : du légo à l’égo. Une passerelle surplombe une vaste zone de travaux, un chantier, celui d’un congrès ou celui de la cure aussi bien. Soudain le chantier de légos en construction s’effondre sur la passerelle. Chaque séance dans la cure est comme cette passerelle qui recouvre et révèle le chantier en construction de l’égo. Je suis ce que je dis nie la dimension de ce savoir à découvrir, à inventer, touche à l’horreur de savoir, de ça voir.
« Écrire ce nouveau savoir suppose un sujet qui veuille le faire. C’est un désir nouveau dans l’histoire : se faire l’agent du discours du psychanalyste. […] L’humanité, le pour-tout homme, ce que Lacan appellera ensuite LOM, ne veut pas savoir, elle veut continuer à rêver du bonheur » [4].
Catherine Stef
__________________
[1] Cf. Lacan J., « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 197-213.
[2] Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 449.
[3] https://www.causefreudienne.org/evenements/je-suis-ce-que-je-dis/
[4] Laurent É., « Le désir du psychanalyste et son rapport à l’écriture », Hebdo-blog, n°273, 13 juin 2022, https://www.hebdo-blog.fr/le-desir-du-psychanalyste-et-son-rapport-a-lecriture/