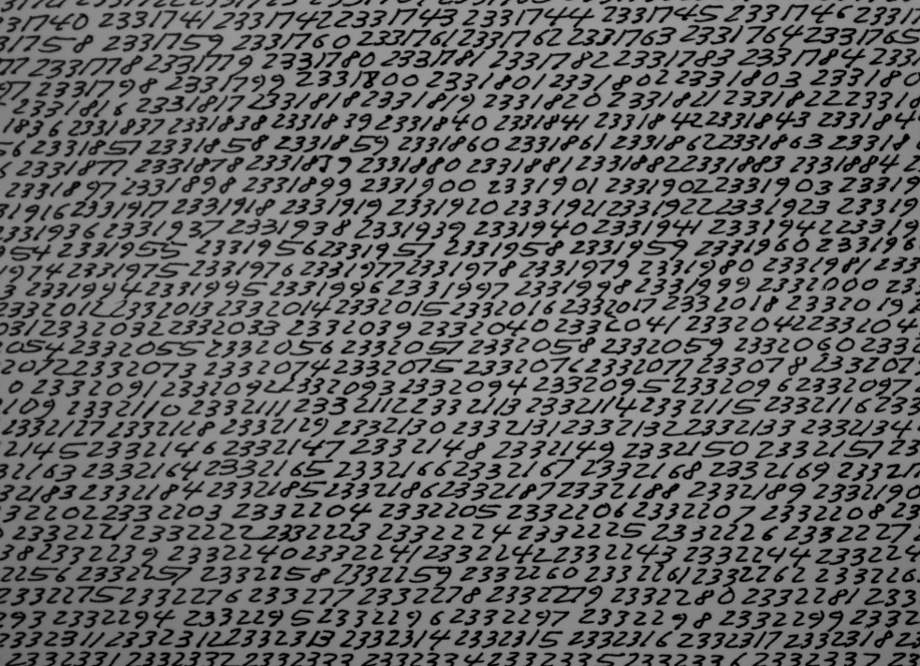Singulières incarnations
La psychanalyse d’orientation lacanienne s’incarne dans chacune des villes, non dans une application hiérarchique et verticalisée, mais bien dans une interprétation, une incarnation, chaque fois unique, et singulière.
Lire la suite