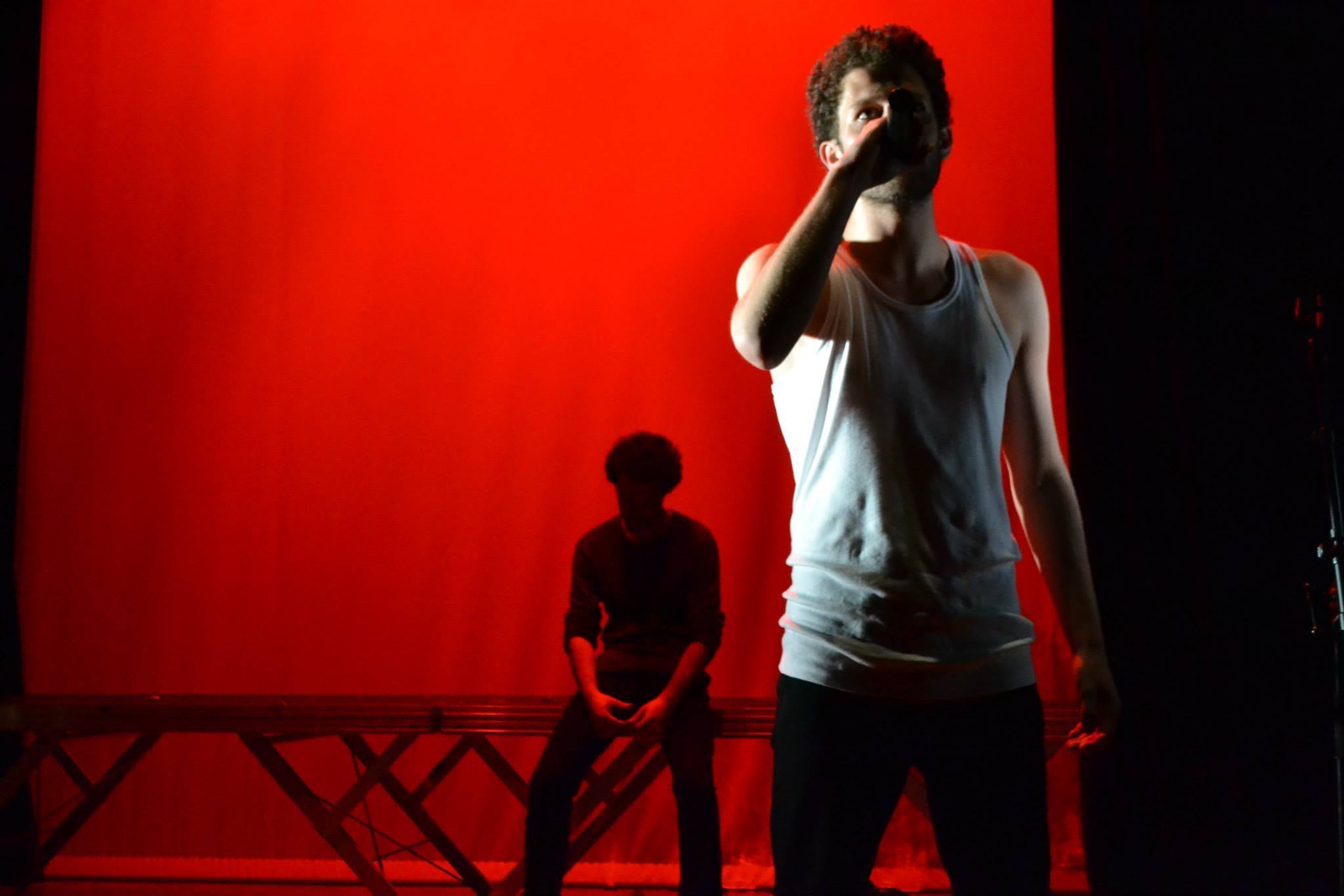La gratuité du traitement psychanalytique proposé par les CPCT a contribué à drainer en priorité des sujets en état de précarité matérielle, mais aussi le plus souvent doublée d’une précarité du symbolique. Pour ces sujets, il faut au cas par cas inventer et construire les conditions d’un lien social en rapport avec leur particularité.
L’expérience de ces cas a déjà donné lieu à de nombreux travaux mettant en relief l’efficacité du traitement pour ces sujets, comme on dit, pleins d’avenir.
Reste oublié, me semble-t-il, un type de précarité qui, pour réelle qu’elle soit, n’en n’est pas moins, elle aussi, souvent symbolique. Je veux parler ici des personnes âgées. Rares, il est vrai, sont ces personnes à solliciter un rendez-vous. Certes le CPCT n’a pas vocation à suppléer aux carences d’une maison de retraite. On ne nie pas non plus les ravages d’un vieillissement peu propice au déplacement, au propre comme au figuré. Néanmoins, les progrès de la médicalisation sont tels, qu’ils permettent aujourd’hui de retarder certaines échéances inéluctables. L’analyste peut donc vouloir traiter la souffrance subjective de ces personnes âgées en leur offrant une autre perspective que celle de survivre.
La visite de la vieille dame « indigne »
Mme T., 78 ans, veuve depuis quinze ans, vient consulter au CPCT dont on lui a dit grand bien. Depuis le décès de son époux, elle est triste et insomniaque. Ses multiples activités bénévoles, qui lui valent la sympathie de son quartier, n’ont pas remédié à ce qu’elle considère comme une perte du goût de vivre. À cela, cette personne fort alerte et loquace, allègue deux raisons :
- l’idée insupportable qu’elle a de savoir qu’on a jeté le corps de son mari dans une fosse commune, parce qu’il avait légué son corps à la science : « À peine froid – dit-elle – il m’a été enlevé. »
- le souci que lui procure sa fille de 45 ans surdouée mais asociale.
Il y aura, comme convenu au CPCT, un traitement de seize séances.
Dès la deuxième séance, nous avons une idée de l’embrouille, avec une explication teintée d’un demi mensonge. Mme T, toujours tracassée par l’état de sa fille, propose sa version. « Pour moi, sur son lit de mort, son père si exigeant l’a chargée d’un mandat trop lourd. »
— Lequel ? — « S’occuper de moi. » — En êtes-vous sûre ? lui ai-je rétorqué. À quoi, ébranlée, elle répond : « À vrai dire, ils se sont vus une dernière fois, mon mari m’a demandé de sortir et je n’ai jamais su ce qu’ils ont pu se dire. / Fin de séance. /
Après cet aveu, Mme T. va reconnaître la part de responsabilité qu’elle partage avec son défunt mari quant au caractère asocial de leur fille : « Dès le départ – dit-elle – on l’a trop adorée. » — Comment cela ? — « On a poussé la bêtise jusqu’à vouloir la concevoir à l’air pur de la Suisse. Ensuite, accouchant à Bombay où nous travaillions, j’ai pensé qu’on ne saurait pas couper le cordon. » / Fin de séance, bien sûr. /
Jusqu’à la dixième séance, elle va néanmoins persister à se plaindre de l’incurie de sa fille qui néglige ses devoirs les plus élémentaires et ne cesse de lui demander de l’argent.
À la dixième séance, l’incroyable arrive : sa fille l’accompagne. À n’en pas douter, dit-elle, c’est mon changement qui l’a persuadée de venir demander un rendez-vous. « Puisse-t-elle respecter sa parole ! » ajoute-t-elle.
La treizième séance marquera un retour vers ce qui aurait pu passer pour un état dépressif. On lui a diagnostiqué un ulcère gastrique, rongée qu’elle est par les frasques de sa fille. Elle veut, dit-elle, « mourir dans la dignité » et me demande si je ne pourrais pas lui indiquer l’adresse d’une clinique en Suisse. À quoi je réplique que si dignité il y a, elle doit se trouver dans la réalisation de ce qu’elle désire dans ce qui lui reste à vivre.
La quatorzième séance va s’avérer décisive en donnant lieu à un dénouement surprenant. Elle concède en riant que sa fille et son mari sont « hors normes ». Elle a fait ce qu’elle a pu et, ajoute-t-elle, « c’est mieux que rien ». C’est alors qu’elle livre un aveu qu’elle avait jusque-là réprimé : après m’avoir fait part d’une information concernant son frère handicapé, « un corps inerte », dit-elle, elle m’avoue ne pas avoir respecté totalement les dernières volontés de son mari. Certes elle avait consenti à ne pas s’opposer au rapt de son corps par la science, mais il y avait autre chose : son mari lui avait fait promettre de mettre leur fille à la porte, mais elle n’en a pas eu le courage. « Vous comprenez – ajoute-t-elle à ma surprise – c’était trop dur, je n’avais plus de corps. »
Dès lors, l’écheveau se démêle. Comme par hasard, elle va trouver le cimetière où ont été inhumés les restes du corps de son mari, avec ceux qui, comme lui, ont légué leur corps à la médecine. Sur un tumulus a été élevé une stèle à leur mémoire, et Mme T. a pu avoir le droit d’y apposer, pour un laps de temps, une plaque avec le nom de son mari.
Désormais, elle estime avoir accompli sa mission. Le corps de son mari a bénéficié à ses yeux d’une sépulture décente. Quant à sa fille, qui a planté une fleur avec elle dans le cimetière, elle sait désormais qu’elle sera toujours hors-norme et qu’elle ne pourra rien y changer.
En partant, tout en me laissant sa carte de visite, elle me prie de bien vouloir de sa part remercier le CPCT.
Que dire d’un tel cas ?
- D’abord qu’il contrevient aux clichés d’une vieillesse standardisée.
- Que la déprise sociale a des coordonnées complexes et inattendues, déjouant les visées adaptatives ou les meilleures aides samaritaines.
Maintenant, et avant tout diagnostic de structure, quelle fut d’abord la raison de l’embrouille où se trouvaient mêlés mère, fille et fantôme du père ?
À l’évidence, la disjonction constatée de la première volonté du défunt, d’avec sa deuxième volonté, a été déterminante pour entraver ce qui aurait dû constituer un travail de deuil. En léguant son corps à la science, le défunt avait cru devoir faire un don à la communauté humaine, mais pour son épouse qui ne partageait pas cet idéal, ce don ne fut qu’un rapt. Pour supporter une telle perte non signifiantisable, elle n’a eu alors d’autres ressources que de tenter de colmater ce trou en substituant fantasmatiquement à ce corps qui lui était ainsi dérobé, le corps de sa fille fétichisé. Ce faisant, elle contrevenait ainsi à l’expulsion de la fille exigée par le père. Avant qu’elle puisse avouer une telle substitution, elle l’avait déjà laissé deviner quand elle avait émis le souhait d’aller se faire euthanasier en Suisse, soit au lieu même de la conception programmée de la fille rêvée comme un être parfait par ses deux parents.
Ainsi nous demandait-elle l’autorisation de se « suissider », si j’ose dire. Refusant de céder à sa demande de mort, nous lui objectons ce qui de son désir est encore à réaliser dans son reste de vie.
C’est seulement après notre opposition qu’elle se décide à dire ce que jusque-là elle avait réprimé et tenu secret. Non sans honte, elle avoue : « Avec elle [sa fille], vous comprenez, j’avais un corps. »
Comment entendre un tel aveu qui eut un effet de coup de théâtre ? « Avec elle, j’avais un corps », s’agissait-il d’une incorporation de l’objet perdu tel que le réalise la mélancolie ? Ou bien ne faisait-elle qu’émettre le désir d’une présence faisant rempart à sa solitude ?
Outre la pacification procurée par les rites du deuil, on ne notait pas vraiment de signes accusés de dépression chez cette dame qui, par ailleurs, égayait la salle d’attente du CPCT, mais plutôt des idées obsédantes concernant les écarts de sa fille. Donc, j’opterai pour un diagnostic de structure obsessionnelle aux prises avec un deuil entravé pour des raisons exceptionnelles, mais aussi empêché par l’hainamoration à l’égard d’une fille trop chérie.
Bref, on a pu, dans le récit de ce cas, suivre le destin d’un corps en souffrance, d’abord errant dans l’entre-deux-morts dans le discours de cette femme, jusqu’à l’aveu de l’objet de sa jouissance fantasmatique.
C’est la hâte suscitée par la date butoir de la fin du traitement qui a permis à ce corps de trouver enfin sa juste place dans le discours, c’est-à-dire comme objet a et sous une nomination, le différenciant ainsi radicalement d’un déchet quelconque, ou même d’un objet d’amour partagé.