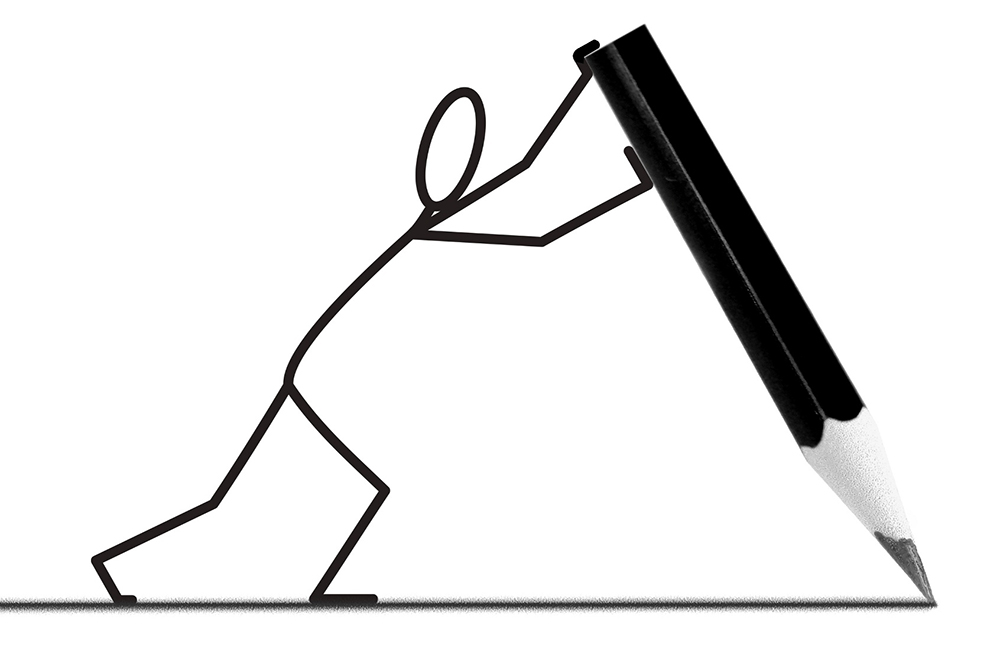L’Être mère : à chaque mère, une solution !
Notre après midi du 18 octobre a donné la parole à L’ÊTRE MÈRE À NANTES. Ce qu’enseigne la psychanalyse c’est que l’être mère pose la question de lecture au cas par cas. Comme le questionne Christiane Alberti dans l’argument des journées, être mère n’est pas quelque chose qui se passe dans son corps uniquement. Avec l’enseignement de Lacan, nous pouvons avancer sur le fait qu’avoir un enfant, dans son ventre ou dans la réalité, est tout autre chose que de l’avoir dans sa préoccupation, dans son esprit.
Avoir un enfant cela peut être tout à fait satisfaisant pour la mère, mais cela peut tout aussi la confronter à un moment d’étrangeté. Dans la clinique nous pouvons rencontrer des mères pour qui l’enfant qui est là représente à la fois l’objet qui lui manque, la comble, mais aussi l’angoisse, l’inquiète. Et pour chacune des mères cela n’est pas chose facile.
Alors on peut répondre par un enseignement aux mères, à s’exercer à ce métier de la maternité, en donnant des modes d’emploi. Heureusement, Lacan nous indique dans sa Note sur l’enfant, que tout cela ne vaut que pris dans « un désir qui ne soit pas anonyme »[1].
À chaque mère, un lien à un enfant. Être mère est une solution que chacune trouve pour faire entrer son enfant dans ce qu’on appelle couramment sa préoccupation maternelle. Être mère, c’est aussi trouver une manière de faire avec cette question, trouver un arrangement, une solution singulière que la rencontre avec un psychanalyste peut aider à élaborer.
Chez Freud, être mère a été la première réponse phallique : au manque de la femme répondait l’avoir de la mère. L’enfant est alors un substitut phallique, la femme ayant trouvé dans l’enfant ce petit avoir qu’elle n’a pas et que son père ne peut lui donner.
Dans son rôle œdipien le père venait barrer la jouissance maternelle, celle de posséder son produit. Le père était le garant de la séparation de la mère et de son enfant ; par son intervention il empêchait la mère de dévorer l’enfant. Cette figure de dévoration, Lacan l’a transformée en celle de la bouche du crocodile que le phallus paternel vient empêcher de se refermer sur l’enfant[2]. Quand le Nom-du-Père peut barrer la jouissance de la mère, celle-ci devient symbolique : au désir de la mère peut se substituer le Nom-du-Père, laissant alors à l’enfant la possibilité de s’inscrire dans la castration, le manque et donc le désir. Lorsque l’enfant ne répond pas à la demande, il l’oblige à désirer en dehors de lui : la mère est d’abord une femme et son désir d’ailleurs permettra à l’enfant de se confronter à un manque et de cheminer vers son désir. Lorsque l’enfant satisfait la mère, ce n’est qu’au travers de son image phallique à elle la mère : ce que sa mère désire en lui, sature en lui, satisfait en lui, ce n’est rien d’autre que le phallus[3]. Ne pas être ce phallus de la mère crée une « discordance imaginaire »[4]. Il divise alors la mère, entre mère et femme.
Derrière la mère, une femme. Et Jacques-Alain Miller le rappelle[5]: une mère, quels que soient les soins qu’elle apporte à son enfant, cela ne doit pas la détourner de désirer en tant que femme. Sinon, c’est l’angoisse: un enfant qui comble sa mère l’angoisse au sens où elle ne désire plus en tant que femme. Autant la vraie femme est celle qui, sous la figure de Médée, peut aller jusqu’à tuer la progéniture de son mari Jason pour rester femme, autant la mère est celle du don symbolique, de l’amour, soit de ce qu’elle n’a pas. Le texte de Nathalie Leveau ouvre la discussion en effet sur cette division entre la mère et la femme.
[1] Lacan J., « Note sur l’enfant », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 373. [2] Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1991, p. 129. [3] Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La relation d’objet, Paris, Seuil, 1994, p. 56. [4] Ibid., p. 57. [5] Miller J.-A., « L’enfant et l’objet », La petite girafe, n° 18, Agalma, 2003. Lire la suite