Éditorial
Entre l’homme et la femme,
Il y a l’amour.
Entre l’homme et l’amour,
Il y a un monde.
Entre l’homme et le monde,
Il y a un mur.
Jacques Lacan, Je parle aux murs
Un mur ?
Et laisse-t-on vraiment aujourd’hui « les agences matrimoniales aux mains de mémères qui ont de l’expérience »[1], comme le disait Jacques-Alain Miller à Commandatuba en 2004, tout en ajoutant que si « on n’a pas encore installé les évaluateurs dans les agences matrimoniales ? Ça ne saurait tarder ! »[2]
Vous n’étiez pas sans savoir que chez Unicis, un conseiller pouvait réaliser pour vous, et sans engagement de votre part, une présélection de trois personnes dûment sélectionnées et fichées, qui allaient vous correspondre. Délivrés du langage, vous alliez vous livrer, corps et âme, à cette recherche dont l’issue rapide vous offrait trois profils. Retenus pour leur bonne adéquation avec vous, ils vous garantissaient satisfaction. Chez Unicis, ça s’appelait l'affinité réciproque. La conseillère était en mesure, vous l’aviez expérimenté, de vous permettre de bonnes rencontres, grâce à un subtil questionnaire psycho-relationnel.
Has been que cela !
Vous avez lu le Flash lacanien du 9 juillet et le texte de Dominique Pasco et savez désormais que le magazine Marie-Claire de Juillet 2015 consacre trois pages aux e-rencontres. Notre collègue précise dans son flash la part de la référence aux statistiques dans cet état des lieux de la e-rencontre : « On y apprend que les sites sont désormais vintages, quasi obsolètes et délogés par les applications qui permettent un accès plus immédiat avec géolocalisation et gratuité. Quinze à dix-huit millions de célibataires offrent une perspective incroyable à ces nouvelles modalités d’entrer en contact ».
Vous en doutez ? Vous me répondez, d’un autre site.com, celui de la psychanalyse lacanienne… que… il n’y a pas de rapport sexuel ?
Pour ce 14 juillet, cet Hebdo-Blog n° 40 est un feu d’artifice, ça fuse !
Voici la seconde édition spéciale 45es Journées. Nos rubriques « Dossier », « ACF », « Hors-piste », « Tiré à part », « Comment l’entendez-vous ? », « Arts &Lettres », « HB-Nos livres », sont au rendez-vous !
Nous vous emmènerons vers l’aube, quand « la cumparsita vient clore chaque nuit » (Laurent Dumoulin) et vers ce lieu de « la rencontre amoureuse entre deux sexes, permise là où il n’y a pas de rapport sexuel » (Marcelo Denis). Si, aujourd’hui « on jouit d’abord, on court-circuite le désir et il reste à aimer », nous dit Sonia Chiriaco – nulle invitation à gémir car « à la place du rapport sexuel qui n’existe pas, les parlêtres ont inventé l’amour. Et on en parle encore ! » Savez-vous d’ailleurs que « S’il n’y a pas de bon heur, il y a des rencontres qui donnent du peps ! » ? (Véronique Servais)
Certaines rencontres, aussi, ravissent. Lisez le texte de René Fiori lorsqu’il célèbre le livre Du mariage considéré comme un des beaux-arts, de Philippe Sollers et Julia Kristeva, « Ce livre est un régal tant les auteurs ont à cœur de nous prendre dans les plis, nous impliquer dans les suites de leur rencontre qui ne cesse de s’écrire jusqu’à aujourd’hui ».
Ce n’est pas de ravissement qu’il s’agit dans la « brève rencontre » de Claude Lanzmann, en Corée du Nord, avec Kim Kum-sum, mais d’éclair, de fulgurance du désir, de ruse et de rencontre avec une marque sur le corps de l’autre qui attise encore l’embrasement des corps-parlants. C’est cela qu’évoque pour nous Damien Guyonnet qui a su extraire des Mémoires de C. Lanzmann cette perle rare. Littérature, encore, Caroline Leduc débusque dans le premier roman de Witold Grombowicz l’amour qui se cache derrière celui de Jojo pour une jeune fille, un amour bien singulier. Rappelons que ces deux textes succèdent, dans le dossier, à ceux de deux autres membres du comité de pilotage des J45, Carolina Koretzky et Camilo Ramirez, publiés dans notre première édition spéciale J45 du 29 juin.
Souvenons-nous du numéro 1 de L’Hebdo-Blog, c’était il y a dix mois, le 21 septembre 2014, et du texte Same Sex Procreation, (dans la rubrique Hors-Piste) de François Ansermet. Ici, Marie-Christine Baillehache, René Fiori et Isabelle Galland se sont entretenus avec lui à propos de son dernier livre La fabrication des enfants, un vertige technologique. Ne déflorons pas le contenu de cet entretien riche d’enseignements. Quand bien même F. Ansermet parle de choses fort sérieuses, c’est avec légèreté.
Mais pas de pause estivale sans un retour sur nos pas, sans honorer PIPOL 7 : « Victime ! » Alors que Dominique-Paul Rousseau nous y introduisait, voilà qu’à chaud, tout de go car il vient de nous parvenir, nous avons le plaisir de vous communiquer un texte, politique, de Jean-Daniel Matet, président de l’EuroFédération de psychanalyse et co-organisateur du congrès avec Gil Caroz. Nous l’en remercions.
Prochain rendez-vous avec L’Hebdo-Blog le lundi 7 septembre !
[1] Miller J.-A. « Une fantaisie », Mental, n°15, Revue internationale de santé mentale et de psychanalyse appliquée, Paris, 2005, p. 24 et 25. [2] Ibid., p. 25. Lire la suite



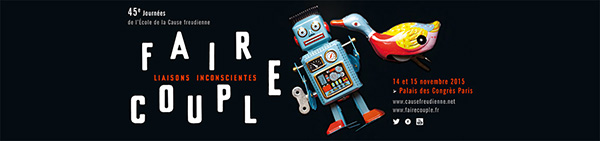


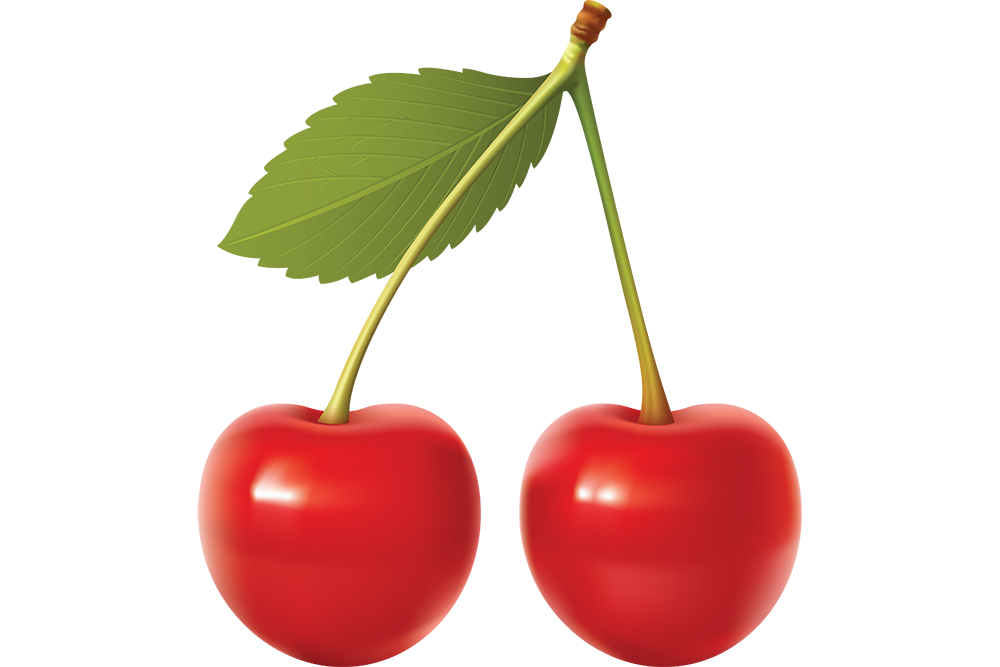




![Entretien avec François Ansermet à propos de son livre La fabrication des enfants, un vertige technologique[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/07/AnsermetHD.png)

