Match Point!
En plein vent
Après l'interview avec le Copil des J-45, l'Hebdo-Blog a invité la directrice des Journées, Christiane Alberti, à nous dire ce que lui inspirait le thème de la rencontre. C'est tambour battant et en connexion directe avec l'époque qu'elle nous apprend que plus ça change plus c'est pareil, mais pas tout à fait quand même...
« Il y a tout de même quelque chose qui a changé. La sexualité est quelque chose de beaucoup plus public. […] La sexualité, c’est toutes sortes de choses, les journaux, les habillements, la façon dont on se conduit, la façon dont les garçons et les filles font ça, un beau jour, en plein vent, sur le marché. » (Lacan, Mon enseignement, p. 28) Nous sommes peu avant 68, et là encore Lacan anticipe notre temps, éclairant certains effets de l’avènement du virtuel dans le rapport entre les sexes.
Je partirai du lancement sur le marché des e-rencontres d’une application mobile (Tinder) qui fait défiler sous vos yeux des portraits de filles et de garçons sur lesquels vous pouvez cliquer, au gré de vos standards et autres fixations inconscientes, J’aime/J’aime pas. Lorsque la captation est réciproque, il y a « Match ! ». C’est dans la poche ! Vous pouvez dès lors fixer un rendez-vous à celui ou celle qui vous a « aimé » le temps d’un instant. Ce n’est pas obligatoire, puisque vous pouvez vous contenter du nombre de matchs réalisés, en vertu d’un alignement de l’ordre érotique sur une comptabilité qui semble prévaloir sur les rencontres effectives. Combien ? semble être pour certains le seul intérêt de l’affaire, comme pour Victor, nostalgique de la période où « ça débitait pas mal ».
Si on ne se laisse pas gagner par le dégoût hystérique, plusieurs choses retiennent l’attention dans les témoignages des utilisateurs de Tinder, tels que France Ortelli et Thomas Bornot les ont recueillis dans leur film Love me Tinder.
Où es-tu ?
On se rend sur Tinder « parce que tout le monde est là, tout Paris y est ! » Tinder est d’abord un lieu : nécessité de situer l’Autre dès lors qu’il a disparu. On le cherche et on le trouve : l’application mobile a pris la place du marché. L’Autre organise les rapports entre les sexes parce que le rapport sexuel fait précisément défaut. L’Autre qui arrangeait les mariages selon les semblants de la tradition, les médiations convenues, est ici remplacé par l’application, mais il s’agit toujours d’un arrangement par un Autre de pacotille.
L’Autre de Tinder, comme dans la tradition, organise les liens selon les canons masculins, paternels, scopiques : « on voit une jolie fille, on clique, on l’a ! » Enfin la vraie vie ?
C’est fait !
La temporalité est au premier plan dans les propos des protagonistes. Le scénario de la rencontre étant déjà écrit, prescrit par l’application elle-même, « on sait déjà que cela se terminera au lit, alors autant accélérer le mouvement, ce sera fait ! »
N’est-ce pas le rêve de beaucoup d’hommes ? Brûler toutes les étapes, éviter tous les préliminaires gagnés à la sueur de son art de la séduction pour arriver tout de suite à la première fois et réduire ainsi le temps qui nourrit l’inquiétude, voire l’angoisse de ce qui sera.
Disons que le montage pulsionnel se fait autrement, suivant une autre temporalité : on baise d’abord, on voit ensuite. Le symbolique a changé le tempo, on danse le rock and roll à l’envers, un signe et hop ! Cela n’en demeure pas moins un montage. La sexualité a beau être en en plein vent, le sexe fait toujours « trou dans la vérité ». On n’en sera pas quitte.
ça visse exuelle
On pourrait lire cette subjectivité du temps, la multiplication des rencontres sans lendemain, comme une banalisation de l’acte sexuel « qui n’a pas plus d’importance, dit-on, que de boire un verre d’eau » (Lacan, Mon enseignement, p. 33).
La soi-disant indifférence n’est-elle pas à lire plutôt comme une défense que le jeu de mot de Lacan épingle clairement : ça visse exuelle. L’équivoque du vissé fait résonner le réprimé interne à la sexualité elle-même : c’est le contraire de « sans importance ».
Vraies et fausses rencontres
Vouloir en finir au plus vite, n’est-ce pas court-circuiter l’angoisse, le trouble que suscite l’imprévu, et trouver ainsi une parade à la rencontre réelle, en tant qu’elle fait fond sur l’impossible ?
Que ce soit convenu par un clic ou arrangé par la tradition, le plus dur reste à faire au sens où la vraie rencontre reste à consommer. Faire couple nécessitera d’en passer par le symptôme qui en son principe nous isole. Sur ce plan, l’Autre sera toujours de pacotille. Reste la contingence. Pas de faire couple sans rencontre préalable. Cupidon a toujours les yeux bandés et tire ses flèches au hasard !
Lire la suite

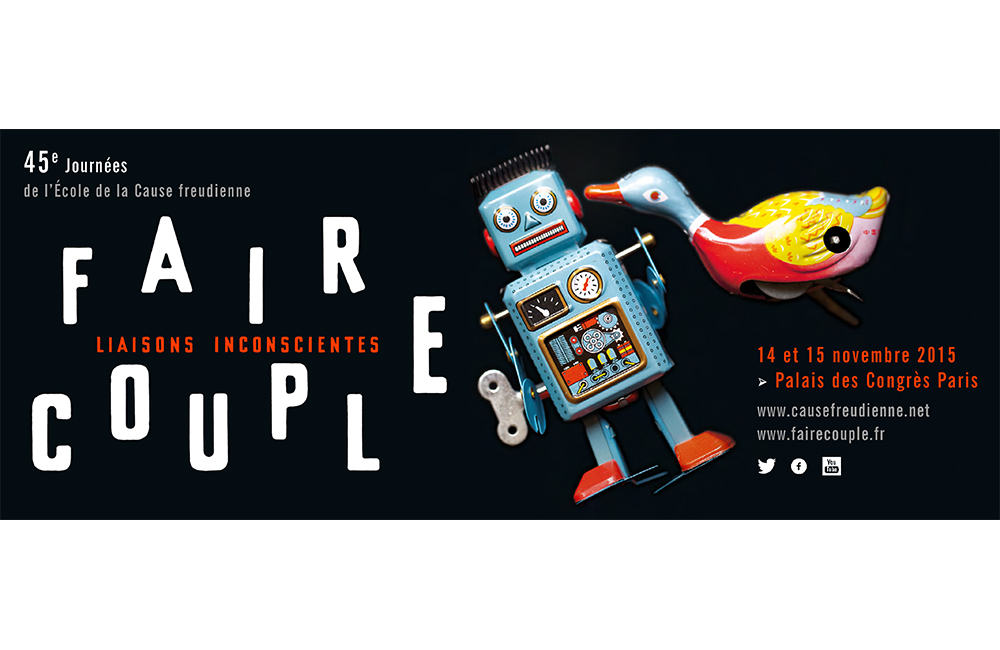
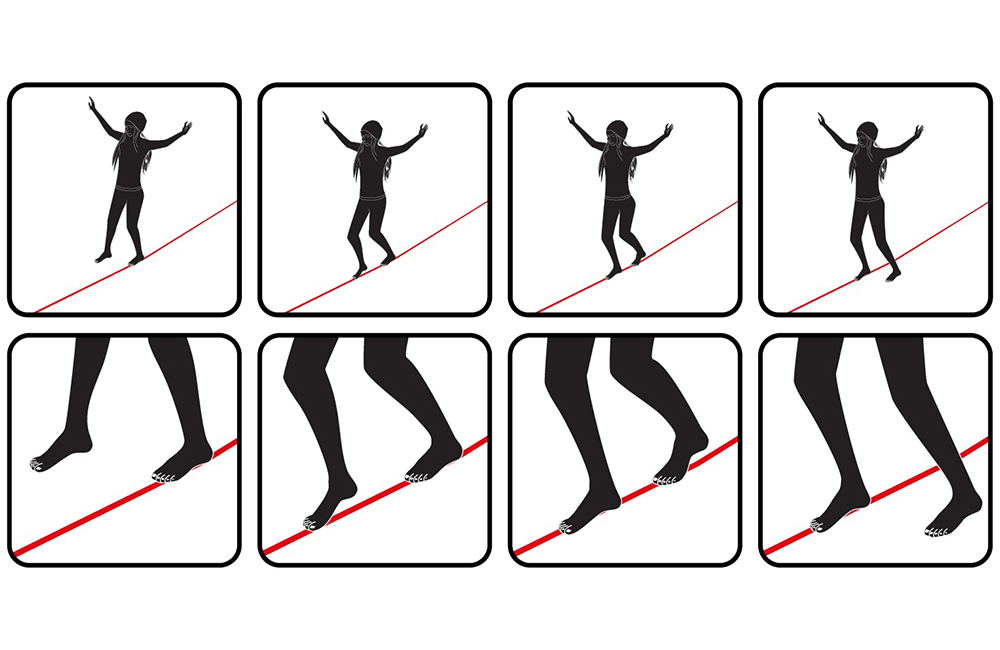


![« Me voici donc seul sur la terre […] »](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/06/blanchetHD.jpg)