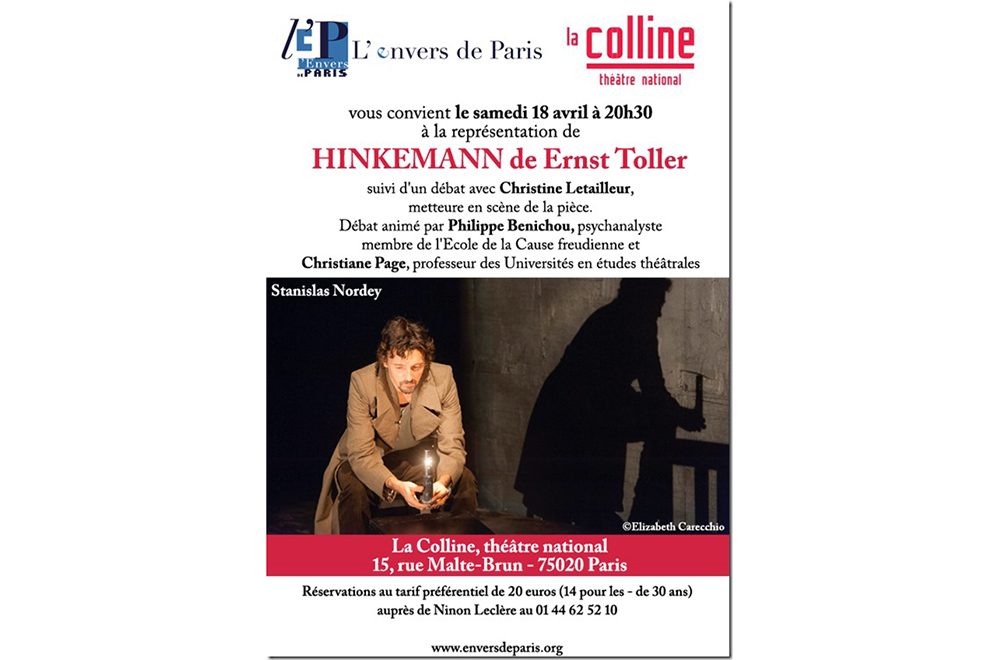Gérard Miller poursuit son étude de portraits, de caractères, d’hommes d’exception, en réalisant avec l’aide d’Anaïs Feuillette des films pour la télévision qui sont à chaque fois applaudis par l’opinion. L’enthousiasme de cet accueil est évidemment mérité, tant chacun des morceaux de cet opus est fabriqué avec intelligence, minutie et conviction, G. Miller proposant avec sa voix soyeuse une interprétation ferme et structurée du personnage qu’il étudie. Ici la forme égale le fond, la délicatesse du style se noue à la profondeur de la perspective pour faire de ces émissions un moment de bonheur télévisuel où l’on a cette impression exquise de se sentir intelligent.
Après DSK l’homme qui voulait tout, c’est Gérard Depardieu qui était mis en scène, pendant une heure et demie, le lundi 23 mars sur FR3, à 20h30, sous le titre : Gérard Depardieu, l’homme dont le père ne parlait pas. Deux millions de téléspectateurs ont regardé ce film dès le lundi soir, et il a fait partie des replay les plus visionnés de la Toile. Les critiques ont été unanimes à saluer la réussite de l’entreprise, quelquefois avec naïveté : « Gérard Miller psychanalyse Gérard Depardieu »[1] ; quelquefois avec finesse : « Ce n’est pas un hasard si après avoir réalisé un document sur DSK, Gérard Miller et Anaïs Feuillette ont souhaité en réaliser un sur Gérard Depardieu. Ils trouvent entre les deux hommes au moins un point commun : l’inconscient de l’acteur, comme celui de l’ancien directeur du FMI, est celui d’un personnage de roman »[2]
Un vrai roman – on pense à Sollers. Pourtant ce n’est pas ce trait là qu’épaissit G. Miller, même si son commentaire tend à donner du sens à la trajectoire d’une vie, en l’orientant selon une ligne simple, un arc élégant, c’est-à-dire en nouant le réel et sa fiction. C’est plutôt le nom de jouissance du sujet que cherche à fixer – au sens photographique – G. Miller dans le portrait qu’il fait. Le bain révélateur est le savoir de la psychanalyse, l’application, l’immersion dans ce bain spécial n’a pas ici de prétention thérapeutique (« section de psychanalyse appliquée, ce qui veut dire de thérapeutique »)[3], mais a vocation de révéler quelque chose qui pouvait passer inaperçu. Par exemple, la thèse qui gouvernait le reportage sur Dominique Strauss-Kahnn était l’illimité de son vouloir. Avec G. Depardieu, même s’il y a ici aussi la découverte d’un personnage que rien n’arrête – est-ce une fascination ?, mais sans doute « l’homme sans ambages »[4] exerce t-il sur tous les hommes un tel attrait –, l’orientation se fait plus avec la petite boussole du nachträglich, du point de capiton, pour dessiner moins un « Je suis ce que je suis » qu’un « Je suis comme mon père ». La voix off de G. Miller dit un commentaire qui sait se lover dans la recommandation de Lacan : « le rhéteur qu’il y a dans l’analyste n’opère que par suggestion. Il suggère, c’est le propre du rhéteur »[5].
« De sa vie, pour ceux qui n’en connaissent que son écume »[6], commence G. Miller avant de plonger dans la nature des vagues qui ont construit ce gigantesque acteur, « il n’y a pas, comme le laisse entendre avec dépit l’opinion commune, deux Gérard Depardieu, celui des valseuses et le russo-belge qui s’enfuit pour ne pas payer le fisc. Il a grossi mais il n’a pas changé. » Il est, comme le dit à un moment sa seconde femme, « immensément fidèle ».
Cet exorde posé, la biographie peut se déployer, écrite sur le mode d’une chronologie minutieuse qui, de Châteauroux à nulle part, à huit cents kilomètres à l’est de Moscou, à travers des interviews de ses amis, de ses femmes, de G. Depardieu lui-même, soutenue par une image toujours élégante, jamais ostentatoire, décrit avec cette neutralité bienveillante qui est le lot du psychanalyste, un homme à la présence inouïe. Pourtant il était né non désiré, d’une mère résignée et d’un père taiseux – le Dédé –, dans une famille de six enfants. « Je suis né là, le long des murs de la rue du Maréchal Joffre, quartier de l’Omèle, à Châteauroux. On vivait dans deux petites pièces, on était les uns sur les autres »[7].
Adolescent, il aurait pu se laisser aller à rien, envahi par l’ennui, mais son désir visible, incandescent, quelque chose d’intense fut remarqué, et « celui qu’on ne pouvait pas retenir » fut accueilli par une famille de bourgeois castelroussins éclairés. Puis il part à Paris avec son copain Michel Pilorgé et très vite il réussit. Jean-Laurent Cochet, à qui il s’impose dès l’instant qu’il le voit, dit de lui : « C’était un viking. Il a fait une entrée fulgurante, inoubliable, dans mon univers. »
Bientôt, G. Depardieu est surpris de « lire pour la première fois des choses gentilles écrites sur un type qui portait le même nom que moi ».
Puis la biographie se déroule : les années 70 avec le succès des Valseuses, son mariage avec Elisabeth et les deux enfants, la maison de Bougival ; les années 80 avec la rencontre avec Truffaut – « Je suis un Jeune Premier agricole », dit l’acteur – ; les années 90 avec Cyrano, l’Oscar du meilleur acteur qu’une cabale montée contre lui l’empêche d’obtenir. C’est la « première attaque fragilisant l’homme à qui tout réussissait ». Déprimé par Hollywood, il trouve des racines angevines, et les images sont belles où, avec Jean Carmet – encore un père de substitution –, ils se font, comme deux jeunes poulains qu’ils ne sont plus, des tendresses inquiètes. Jean Carmet meurt, et Barbara et Marguerite Duras. « Je suis vide », dit G. Depardieu.
« L’arrivée du XXIe siècle allait sonner définitivement le glas du bonheur », note en écho G. Miller. Guillaume, le fils de G. Depardieu, meurt. À l’église, celui-ci lit la fin du Petit Prince : « -Tu comprends. C’est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C’est trop lourd »[8].
C’était fini. « La suite était du bonus », comme dit l’un de ses amis. Il n’habite pas le château qu’il a acheté, c’est pour le regard des autres, lui habite en face. « Je n’ai aucune sensation de bien-être de propriétaire. » Dans Mammuth, il roule en moto à la recherche d’un passé improbable. Dans son dernier film, il retrouve Isabelle Huppert pour partir dans Valley of Love à la recherche d’un fils disparu.
Trente ans d’analyse n’ont pas réussi à mordre sur ceci que « Gérard Depardieu n’a jamais eu d’aptitude au bonheur ». Il n’a cessé de rencontrer des pères, de Mahomet à Mitterrand, sans pouvoir jamais se fixer à un objet perdu dès le départ. « Je voulais des enfants, mais pour la suite je ne savais pas. Il aurait fallu que je trouve les mots, mais les mots je ne les avais pas. J’ai la capacité de dire ceux des autres mais, pour les miens, je suis toujours le fils de Dédé. »
Il est finalement l’envers du Cyrano qu’il incarna si bien, qui parlait autant qu’il voulait, mais était empêtré par son corps. G. Miller avait autrefois fait un exposé sur le masochisme du héros de Rostand qui toujours renonce à accueillir les fruits de la gloire : « Eh bien ! toute ma vie est là : Pendant que je restais en bas, dans l’ombre noire, D’autres montaient cueillir le baiser de la gloire ! »[9] Depardieu, dit Miller, est l’homme dont le père ne parlait pas, et qui d’ailleurs dut, au début de sa carrière, prendre des cours d’orthophonie pour apprendre à parler. Et peut-être « son long voyage, ajoute-t-il, ne fait-il que le ramener dans le Berry, à Châteauroux…/… Il est resté l’enfant à qui son père n’avait jamais dit non, à qui sa mère avait toujours laissé sa porte ouverte. »
Oui sans doute. Mais ajoutons peut-être, avec notre misérable langue de bois, que le sens de l’histoire de cet homme ne sait pas dire comment, pourquoi, cet acteur est un acteur de lalangue. Par exemple, jouant Britannicus au début de sa carrière, G. Depardieu rapporte que, disant : « J’aime, (que dis-je, aimer ?), j’idolâtre Junie. »[10], il entendait que Junie jaillissait de l’âtre où elle gisait. Et il ajoute : « Ce n’était pas si loin, ce sens caché ». Nombreux sont ceux qui ont noté ses deux voix, la douce et la tonitruante. Chacun voit bien que G. Depardieu est un familier de sa lalangue, et aussi qu’il est un corps, une présence, un charisme sans racines, un corps parlant.
Son dernier mot ce n’est pas « Mon panache » cher à Cyrano c’est, dans une interview au Courrier de l’Ouest, au moment du dernier Festival Premiers Plans : « On m’a viré de la France. » [11]
Je ne sais plus comment m’habiter.
[1] TV mag,
www:/BFMTV.com.culture/gerard-miller-psychanalyse-depardieu
[2] www:/France3.fr
[3] Lacan J., « Acte de fondation »,
Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 231.
[4] Lacan J., « Subversion du sujet... »,
Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 825.
[5] Lacan J., « Le moment de conclure »,
Ornicar ?, Bulletin Périodique du Champ Freudien, Automne 1979, 19, p. 8.
[6] Miller G., Feuillette A.,
Gérard Depardieu, l’homme dont le père ne parlait pas, 2015, 90 minutes, production Morgane-Deux cafés l’addition,
idem pour les citations suivantes sauf autres occurences.
[7] Depardieu G.,
ça s’est fait comme ça, XO éditions, 2014, p. 11.
[8] Saint-Exupery (de) A.,
Le Petit Prince, Paris, Gallimard, 1946, p. 88.
[9] Rostand E,.
Cyrano de Bergerac, Acte V, scène VI, 2500, Paris, Le Livre de Poche, 2011, p. 345.
[10] Racine J.,
Britannicus, Acte II, scène II, 380, Paris, Folio, 2000, p. 72.
[11] Courrier de l’Ouest du 19 janvier 2015.
Lire la suite