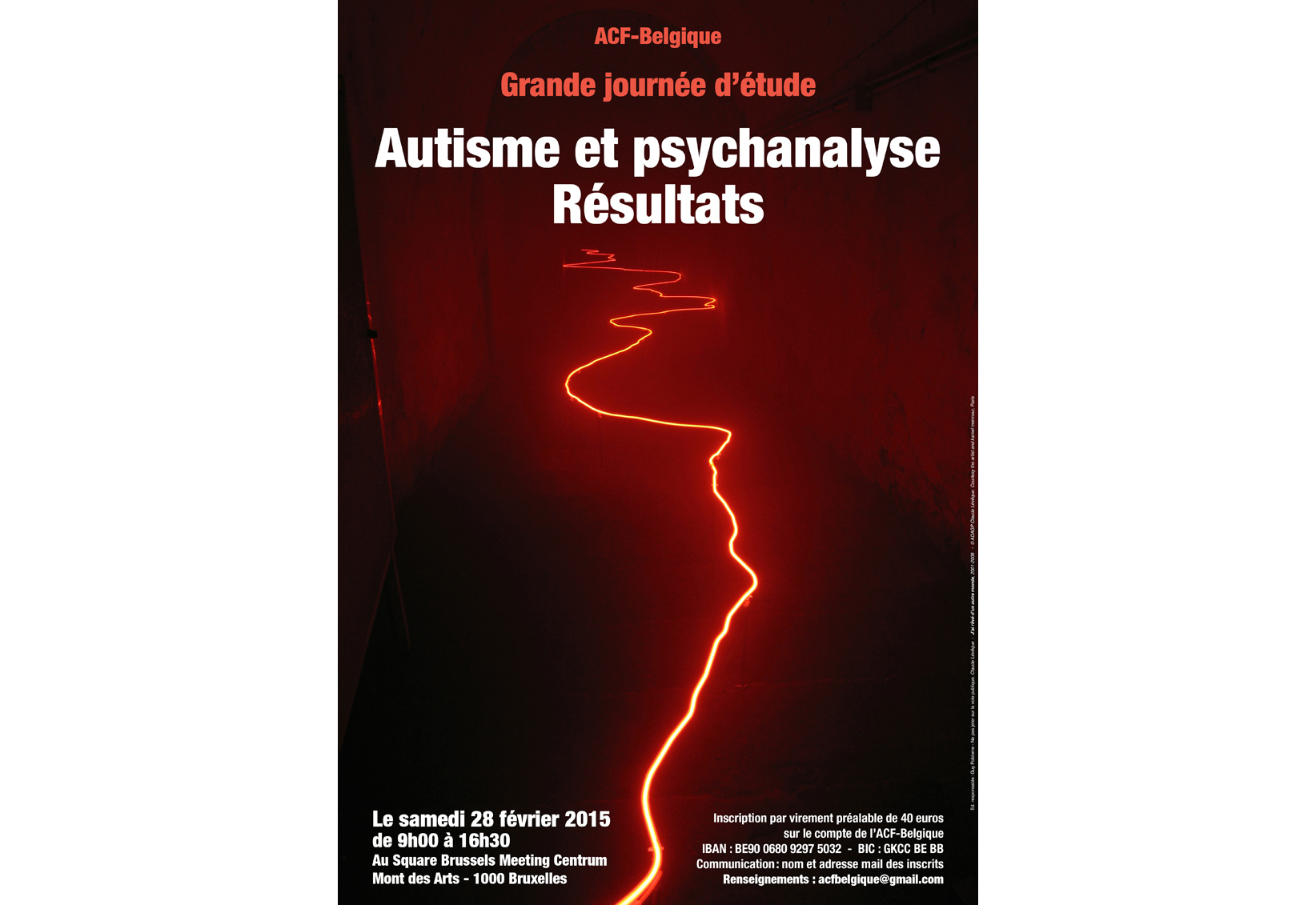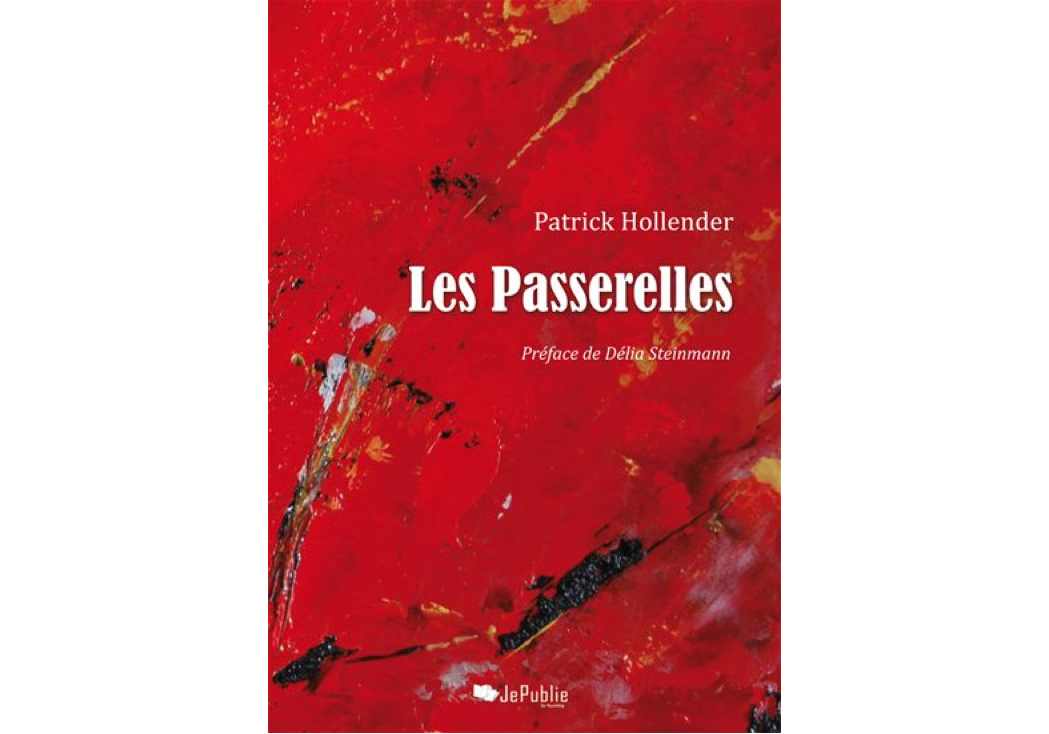Rendez-vous à Bruxelles le samedi 28 février ! Entretien avec Guy Poblome
Le 28 février, à Bruxelles, l’ACF-Belgique organise une Grande journée d’étude intitulée : « Autisme et psychanalyse. Résultats. » Guy Poblome, président de l’ACF-Belgique, a bien voulu répondre aux questions de l'Hebdo-Blog pour éclairer cet événement dont il est le maître d’oeuvre.
L’Hebdo-Blog – L’annonce de la Journée d’Étude organisée par l’ACF-Belgique à Bruxelles ce 28 février sous le titre « Autisme et psychanalyse : résultats » précise que la psychanalyse lacanienne, ainsi que de nombreuses pratiques en institution, nous donne les outils pour résister au formatage des sujets autistes. Pourriez-vous nous dire précisément ce qu'il en est aujourd’hui des recommandations en Belgique ?
Guy Poblome – Deux études ont été menées en Belgique ces dernières années. La première par le CSS (Conseil Supérieur de la Santé), organisme « indépendant », qui ne dépend d’aucun ministère et a émis un Avis en novembre 2013. Il prône de façon univoque les méthodes éducatives et comportementales dans la prise en charge précoce de l’autisme, et notamment la plus « dure » d’entre elles, ABA. La seconde étude émane du KCE (Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé) et a été sollicitée par la ministre de la Santé. Le rapport du KCE a été publié en novembre 2014. Bien que plus nuancé, il centre ses recommandations dans la sphère de l’éducatif et du comportement. La dimension subjective de l’autisme, le refus de l’Autre par exemple, est complètement éludée ou reprise sous le terme de « comorbidité », comme l’est le rapport au langage considéré sous l’angle du déficit. En somme, ce qui sous-tend ces études, c’est que le ressort de l’autisme est de l’ordre du handicap et n’aurait rien à voir avec une « insondable décision de l’être » comme le disait Lacan.
Là où les deux études se rejoignent, c’est pour rejeter la psychanalyse hors du traitement de l’autisme. Elles n’ont pas cherché bien loin puisqu’elles se contentent de se référer à la HAS (Haute Autorité de Santé) française. Ainsi, le sort de la psychanalyse est réglé en deux coups de cuillère à pot. La seule méthode d’investigation envisageable pour ces collèges d’experts est la méthode issue des études randomisées, dite scientifique. Leur credo, c’est EBM ou EBP pour Pratiques Basées sur les Preuves. L’intéressant, c’est que le KCE a l’honnêteté de reconnaître que, « pour de nombreux aspects de la problématique [de l’autisme], la récolte dans la littérature scientifique s'est révélée très maigre » et qu’« appliquer les méthodologies rigoureuses de la recherche evidence-based s’avérait d’office une entreprise hasardeuse ». Le KCE s’est donc reposé sur l’étude de la HAS et son équivalent anglais, et pour ce qui est de la spécificité belge, il a dû s’en remettre à un questionnaire envoyé à des « gens de terrain ». C’est une méthodologie qui se base sur le consensus. Du coup, toute une série de questions peuvent se poser : comment le questionnaire a-t-il été établi ? Comment a-t-on constitué la liste des « gens de terrain », à qui ce questionnaire a-t-il été envoyé ? Etc.
L’HB – Quel poids ont eu les batailles menées par les psychanalystes ? Que pouvez-vous dire des effets produits par les deux films « D’autres voix » et « À ciel ouvert », films qui chacun, rendent compte de la rencontre de la psychanalyse avec les sujets autistes ? Ces projections et les vifs débats qui les ont accompagnés ont-ils permis selon vous à la psychanalyse ainsi qu’aux pratiques institutionnelles qui en découlent de témoigner de leur « efficacité » ?
GP – En Belgique, il n’y a pas pour le moment de Plan autisme comme en France. Le problème de la prise en charge de l’autisme est par conséquent moins médiatisé. Les films « À ciel ouvert » et « D’autres voix » ont eu un succès certain – et ont eu aussi leurs détracteurs dans les salles – mais n’ont peut-être pas eu le retentissement qu’ils ont connu en France.
Par contre, s’il n’y a pas de Plan autisme belge, des associations de parents en réclament un. L’une d’entre elles notamment est très active et militante, elle écume les couloirs des ministères et des administrations, s’introduit dans les instances pour obtenir la mise en place d’un Plan autisme tout en se faisant le chantre des méthodes comportementales. La conséquence en est qu’elle devient l’unique interlocutrice des mandataires politiques.
C’est pour cette raison qu’après la publication de l’Avis du CSS sur la prise en charge de l’autisme fin 2013, l’ACF-Belgique, en partenariat avec le Kring voor Psychoanalyse de nos collègues flamands, la Section clinique de Bruxelles et l’APCF (Association Psychanalytique de la Cause freudienne), a organisé le forum « Quel plan autisme ? » en mai 2014. Il s’est tenu dans les locaux de l’Université Saint Louis à Bruxelles, a accueilli trois cents participants et a été soutenu par soixante institutions concernées directement par la question de l’autisme. Un numéro du Forum des Psychanalystes y a été consacré. Le but recherché était bien sûr médiatique. Nous avons sollicité les politiques et les administrations, le président de l’AWIPH (Agence wallonne d’Intégration des Personnes Handicapées) également président de l’INAMI (Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité) est venu prononcer un discours en faveur d’une approche plurielle de l’autisme, d’autres mandataires politiques nous ont reçus. Bref, l’objectif poursuivi de se constituer comme interlocuteurs, de remettre ces questions sur la scène du débat démocratique, de ne pas laisser la question de l’autisme à l’hégémonie des comportementalistes a été atteint. Ce qui en témoigne, c’est que la présidente de la Commission de la Santé du parlement fédéral belge, Mme Muriel Gerkens, viendra faire une allocution lors de notre journée du 28 février.
Ce n’est pas tout. Le forum a aussi donné la parole à des parents. Mireille Battut, présidente de l’association La Main à l’Oreille y est venue témoigner de son parcours. D’autres parents, belges, ont parlé de leur rencontre avec la psychanalyse, avec les institutions orientées par la psychanalyse qui ont accueilli leurs enfants. Cela a permis la mise en place d’une antenne belge de La Main à l’Oreille, ce qui n’est pas un effet négligeable de notre action. Même si elle n’en est qu’à ses débuts, cette association a le mérite de faire entendre une autre voix du côté des parents d’enfants autistes.
L’HB – À propos de l'usage des objets que font certains sujets autistes, l’argument de la Journée dit que « le fil du lien passe par là ». Or le discours analytique de l'époque isole souvent le fait que les objets viennent plutôt court-circuiter le lien. Comment, dans le cas des autistes, cet objet peut-il atteindre à la dignité du lien ? Et quel type de lien ?
GP – Nous passons de la politique à la clinique. L’objet autistique est communément considéré comme venant fermer le corps du sujet autiste, venant redoubler son retrait. Et, en effet, il a un rôle de protection par rapport à ce qui est vécu par lui comme une intrusion de l’autre. À ce titre, les mains qui viennent boucher les oreilles peuvent être considérées comme des objets autistiques. Ce que certains posent comme postulat, c’est qu’il faut retirer l’objet pour que l’autiste s’ouvre à la relation. Seulement, cette extraction forcée ne tient pas compte de cette fonction de défense de l’objet et a un effet de mutilation, d’arrachement qui entraîne des crises d’angoisse.
Autre chose est de respecter cet objet, de l’accueillir en tant qu’il est non seulement protecteur, mais aussi en tant qu’il est situé sur une frontière entre le corps du sujet et le champ de l’autre. Accueillir l’objet autistique, travailler à partir de cet objet sur le bord permet de s’introduire comme partenaire non menaçant pour le sujet et de faire entrer cet objet dans un circuit, dans une métonymie, et donc dans un certain échange. Une enseignante expliquait par exemple qu’à la condition d’accepter que l’objet accompagne l’enfant en classe, ce dernier pouvait consentir à le déposer quelques instants, juste à proximité, pour s’affairer aux apprentissages. Le lien dont il s’agit est un lien de bord et inventif, toujours sur un fil en effet. Il arrive que le sujet autiste s’en soutienne pour élaborer un objet plus complexe qui lui permette de faire avec l’autre. Rendez-vous à Bruxelles le 28 février !
Lire la suite